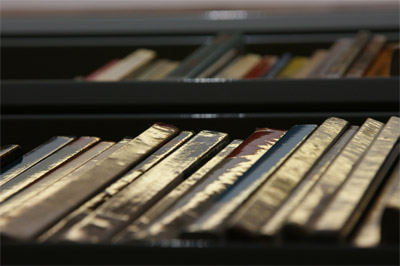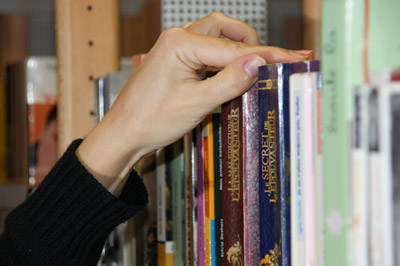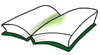Association pour la PrƩvention de la Pollution AtmosphƩrique
DƩtail de la sƩrie
Pollution AtmosphƩrique |
Documents disponibles dans cette série (132)

 Affiner la recherche
Affiner la recherchePollution AtmosphƩrique, 226. Monitoring climate change with lichens as bioindicators / Stapper NJ.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 226 Titre : Monitoring climate change with lichens as bioindicators Titre original : Suivi du changement climatique Ć l'aide des lichens comme bioindicateurs Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Stapper NJ., Auteur ; John V., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : biosurveillance changement climatique climat urbain lichens Ć©piphytes Nord-Ouest de l'Allemagne RĆ©sumĆ© : Les lichens sont connus pour ĆŖtre trĆØs sensibles aux variations de leur environnement. Plus rĆ©cemment, il a Ć©tĆ© montrĆ© qu'ils rĆ©agissent aussi au changement climatique. Une directive (VDI 3957 Partie 20) est en cours et spĆ©cifie 45 Ā« indicateurs de changement climatique Ā», qui sont tous des lichens Ć©piphytes qui correspondent Ć certains critĆØres d'indicateur Ć©cologique rĆ©visĆ© selon Witrh, soit (10-K+T)/2 > 6 avec N < 7 et F > 6, ou si aucun indicateur n'a Ć©tĆ© publiĆ©, les lichens ayant une distribution mĆ©diterranĆ©enne tempĆ©rĆ©e et sub-atlantique-mĆ©diteranĆ©enne sont rĆ©fĆ©rencĆ©s.
Pour Ć©valuer les consĆ©quences Ć©cologiques rĆ©gionales du changement climatique, Ć DĆ¼sseldorf (Allemagne) et aux alentours de la rĆ©gion de Mettmann, des programmes de surveillance Ć long terme, incluant les lichens Ć©piphytes, ont Ć©tĆ© lancĆ©s en 2008 et 2009, respectivement, et dont les rĆ©sultats peuvent ĆŖtre fusionnĆ©s avec ceux des Ć©tudes de lichens antĆ©rieures faites avec la mĆŖme mĆ©thodologie. Ainsi, le changement dynamique des lichens sur les phorophytes sĆ©lectionnĆ©s selon VDI 3957 Partie 13 pourrait ĆŖtre analysĆ© sur la pĆ©riode 2001-2013.
Au fil des ans, un total de 100 espĆØces ont Ć©tĆ© enregistrĆ©es. Alors que le nombre moyen de lichens par phorophyte n'a augmentĆ© que lĆ©gĆØrement, le nombre moyen dā€™indicateurs du changement climatique par arbre a au moins doublĆ© depuis 2001. La frĆ©quence des lichens nitrophiles (exprimĆ©e en proportion de phorophytes avec au moins un thalle des espĆØces correspondantes) reste Ć©levĆ©e, tandis que les lichens acidophiles sont toujours en dĆ©clin. Cependant, la frĆ©quence des indicateurs du changement climatique n'a cessĆ© d'augmenter d'annĆ©e en annĆ©e : Punctelia subrudecta (+2,6 %/an) > P. jeckeri > P. borreri > Flavoparmelia soredians (+0,6 %/an) > Hypotrachyna afrorevoluta (+0,1 %/an) juste pour ne nommer que quelques espĆØces. Certains des lichens indicateurs, par exemple Parmotrema reticulatum ou Physcia tribacioides, n'ont jamais Ć©tĆ© rĆ©fĆ©rencĆ©s auparavant dans DĆ¼sseldorf et sa pĆ©riphĆ©rie urbaine.
Il est suggĆ©rĆ© que ces observations peuvent, au moins en partie, ĆŖtre liĆ©es aux modifications climatiques, puisque dans la zone Ć©tudiĆ©e, la tempĆ©rature annuelle moyenne et le nombre de jours moyen par an avec plus de 25 Ā°C sont en hausse constante.Pollution AtmosphĆ©rique, 226. Monitoring climate change with lichens as bioindicators = Suivi du changement climatique Ć l'aide des lichens comme bioindicateurs [texte imprimĆ©] / Stapper NJ., Auteur ; John V., Auteur . - 2015.
Tags : biosurveillance changement climatique climat urbain lichens Ć©piphytes Nord-Ouest de l'Allemagne RĆ©sumĆ© : Les lichens sont connus pour ĆŖtre trĆØs sensibles aux variations de leur environnement. Plus rĆ©cemment, il a Ć©tĆ© montrĆ© qu'ils rĆ©agissent aussi au changement climatique. Une directive (VDI 3957 Partie 20) est en cours et spĆ©cifie 45 Ā« indicateurs de changement climatique Ā», qui sont tous des lichens Ć©piphytes qui correspondent Ć certains critĆØres d'indicateur Ć©cologique rĆ©visĆ© selon Witrh, soit (10-K+T)/2 > 6 avec N < 7 et F > 6, ou si aucun indicateur n'a Ć©tĆ© publiĆ©, les lichens ayant une distribution mĆ©diterranĆ©enne tempĆ©rĆ©e et sub-atlantique-mĆ©diteranĆ©enne sont rĆ©fĆ©rencĆ©s.
Pour Ć©valuer les consĆ©quences Ć©cologiques rĆ©gionales du changement climatique, Ć DĆ¼sseldorf (Allemagne) et aux alentours de la rĆ©gion de Mettmann, des programmes de surveillance Ć long terme, incluant les lichens Ć©piphytes, ont Ć©tĆ© lancĆ©s en 2008 et 2009, respectivement, et dont les rĆ©sultats peuvent ĆŖtre fusionnĆ©s avec ceux des Ć©tudes de lichens antĆ©rieures faites avec la mĆŖme mĆ©thodologie. Ainsi, le changement dynamique des lichens sur les phorophytes sĆ©lectionnĆ©s selon VDI 3957 Partie 13 pourrait ĆŖtre analysĆ© sur la pĆ©riode 2001-2013.
Au fil des ans, un total de 100 espĆØces ont Ć©tĆ© enregistrĆ©es. Alors que le nombre moyen de lichens par phorophyte n'a augmentĆ© que lĆ©gĆØrement, le nombre moyen dā€™indicateurs du changement climatique par arbre a au moins doublĆ© depuis 2001. La frĆ©quence des lichens nitrophiles (exprimĆ©e en proportion de phorophytes avec au moins un thalle des espĆØces correspondantes) reste Ć©levĆ©e, tandis que les lichens acidophiles sont toujours en dĆ©clin. Cependant, la frĆ©quence des indicateurs du changement climatique n'a cessĆ© d'augmenter d'annĆ©e en annĆ©e : Punctelia subrudecta (+2,6 %/an) > P. jeckeri > P. borreri > Flavoparmelia soredians (+0,6 %/an) > Hypotrachyna afrorevoluta (+0,1 %/an) juste pour ne nommer que quelques espĆØces. Certains des lichens indicateurs, par exemple Parmotrema reticulatum ou Physcia tribacioides, n'ont jamais Ć©tĆ© rĆ©fĆ©rencĆ©s auparavant dans DĆ¼sseldorf et sa pĆ©riphĆ©rie urbaine.
Il est suggĆ©rĆ© que ces observations peuvent, au moins en partie, ĆŖtre liĆ©es aux modifications climatiques, puisque dans la zone Ć©tudiĆ©e, la tempĆ©rature annuelle moyenne et le nombre de jours moyen par an avec plus de 25 Ā°C sont en hausse constante.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L226_StapperAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 226. Relation entre la composition de particules industrielles et leur transfert dans les feuilles de plantes potagĆØres / Dappe V.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 226 Titre : Relation entre la composition de particules industrielles et leur transfert dans les feuilles de plantes potagĆØres Titre original : Relationship between the composition of industrial particles and their transfer in leaves of vegetables Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Dappe V., Auteur ; D. Cuny, Auteur ; B. Hanoune, Auteur ; Dumez S., Auteur ; A. Austruy, Auteur ; Dumat C., Auteur ; S. Sobanska, Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : accumulation particules trĆØs fines (PM1) plomb spĆ©ciation transfert voie foliaire RĆ©sumĆ© : La part des particules fines et trĆØs fines (PM2.5 et PM1) Ć©mises dans lā€™atmosphĆØre a augmentĆ© de maniĆØre significative dans les zones industrielles, en lien avec la mise en place, en sortie dā€™Ć©chappement des usines, de filtres de plus en plus efficaces vis-Ć -vis des fractions granulomĆ©triques plus grossiĆØres. Ces particules fines et trĆØs fines sont trĆØs rĆ©actives et prĆ©sentent donc un risque Ć©levĆ© Ć la fois pour la santĆ© humaine et les milieux environnants (air, sol, eau, vĆ©gĆ©tal). Ces particules microniques et submicroniques sont en effet capables de pĆ©nĆ©trer profondĆ©ment dans l'appareil respiratoire et dā€™atteindre les alvĆ©oles pulmonaires. L'ingestion est Ć©galement une voie d'exposition importante, notamment par la consommation de vĆ©gĆ©taux contaminĆ©s en zones urbaines (oĆ¹ la densitĆ© de population est particuliĆØrement Ć©levĆ©e) et/ou aux abords des zones industrielles. Lā€™Ć©tude de lā€™accumulation et du transfert de particules par voie foliaire chez des vĆ©gĆ©taux cultivĆ©s en proximitĆ© dā€™usines Ć©mettant des particules riches en mĆ©taux est donc d'un intĆ©rĆŖt majeur. Nos travaux concernent lā€™Ć©tude de lā€™accumulation foliaire de particules Ć©mises par une usine de recyclage de batteries au plomb et de leur transfert dans les tissus des feuilles. Dans un premier temps, nous avons caractĆ©risĆ© des particules Ć lā€™Ć©chelle individuelle grĆ¢ce au couplage de techniques spectroscopiques et dā€™imageries. Les rĆ©sultats montrent que le plomb se retrouve majoritairement dans les fractions les plus fines (PM1), essentiellement sous forme de sulfates. Nous avons mis en Ć©vidence la formation de composĆ©s de plomb solubles, en surface des particules. Dans un second temps, des choux ont Ć©tĆ© exposĆ©s aux particules dans lā€™enceinte de lā€™usine pour une durĆ©e de 6 semaines. Les rĆ©sultats montrent une accumulation assez importante de particules contenant du plomb dans les feuilles, sā€™accompagnant parfois de la formation de nĆ©croses enrichies en mĆ©taux. Dans certaines de ces nĆ©croses, la spĆ©ciation du plomb se trouve modifiĆ©e. Afin de mieux comprendre ces phĆ©nomĆØnes bio-physico-chimiques identifiĆ©s sur le terrain, des tests dā€™exposition Ć diffĆ©rents types de particules monomĆ©talliques ont Ć©tĆ© effectuĆ©s en conditions contrĆ´lĆ©es au laboratoire. Les rĆ©sultats, complĆ©tĆ©s par des tests biologiques, montrent des diffĆ©rences significatives dā€™un mĆ©tal Ć un autre, notamment en termes de gĆ©notoxicitĆ© liĆ©e aux mĆ©taux. Pollution AtmosphĆ©rique, 226. Relation entre la composition de particules industrielles et leur transfert dans les feuilles de plantes potagĆØres = Relationship between the composition of industrial particles and their transfer in leaves of vegetables [texte imprimĆ©] / Dappe V., Auteur ; D. Cuny, Auteur ; B. Hanoune, Auteur ; Dumez S., Auteur ; A. Austruy, Auteur ; Dumat C., Auteur ; S. Sobanska, Auteur . - 2015.
Tags : accumulation particules trĆØs fines (PM1) plomb spĆ©ciation transfert voie foliaire RĆ©sumĆ© : La part des particules fines et trĆØs fines (PM2.5 et PM1) Ć©mises dans lā€™atmosphĆØre a augmentĆ© de maniĆØre significative dans les zones industrielles, en lien avec la mise en place, en sortie dā€™Ć©chappement des usines, de filtres de plus en plus efficaces vis-Ć -vis des fractions granulomĆ©triques plus grossiĆØres. Ces particules fines et trĆØs fines sont trĆØs rĆ©actives et prĆ©sentent donc un risque Ć©levĆ© Ć la fois pour la santĆ© humaine et les milieux environnants (air, sol, eau, vĆ©gĆ©tal). Ces particules microniques et submicroniques sont en effet capables de pĆ©nĆ©trer profondĆ©ment dans l'appareil respiratoire et dā€™atteindre les alvĆ©oles pulmonaires. L'ingestion est Ć©galement une voie d'exposition importante, notamment par la consommation de vĆ©gĆ©taux contaminĆ©s en zones urbaines (oĆ¹ la densitĆ© de population est particuliĆØrement Ć©levĆ©e) et/ou aux abords des zones industrielles. Lā€™Ć©tude de lā€™accumulation et du transfert de particules par voie foliaire chez des vĆ©gĆ©taux cultivĆ©s en proximitĆ© dā€™usines Ć©mettant des particules riches en mĆ©taux est donc d'un intĆ©rĆŖt majeur. Nos travaux concernent lā€™Ć©tude de lā€™accumulation foliaire de particules Ć©mises par une usine de recyclage de batteries au plomb et de leur transfert dans les tissus des feuilles. Dans un premier temps, nous avons caractĆ©risĆ© des particules Ć lā€™Ć©chelle individuelle grĆ¢ce au couplage de techniques spectroscopiques et dā€™imageries. Les rĆ©sultats montrent que le plomb se retrouve majoritairement dans les fractions les plus fines (PM1), essentiellement sous forme de sulfates. Nous avons mis en Ć©vidence la formation de composĆ©s de plomb solubles, en surface des particules. Dans un second temps, des choux ont Ć©tĆ© exposĆ©s aux particules dans lā€™enceinte de lā€™usine pour une durĆ©e de 6 semaines. Les rĆ©sultats montrent une accumulation assez importante de particules contenant du plomb dans les feuilles, sā€™accompagnant parfois de la formation de nĆ©croses enrichies en mĆ©taux. Dans certaines de ces nĆ©croses, la spĆ©ciation du plomb se trouve modifiĆ©e. Afin de mieux comprendre ces phĆ©nomĆØnes bio-physico-chimiques identifiĆ©s sur le terrain, des tests dā€™exposition Ć diffĆ©rents types de particules monomĆ©talliques ont Ć©tĆ© effectuĆ©s en conditions contrĆ´lĆ©es au laboratoire. Les rĆ©sultats, complĆ©tĆ©s par des tests biologiques, montrent des diffĆ©rences significatives dā€™un mĆ©tal Ć un autre, notamment en termes de gĆ©notoxicitĆ© liĆ©e aux mĆ©taux. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L226_DappeAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphƩrique, 226. Suivi du changement climatique sur la base d'observations phytophƩnologiques dans la rƩgion de Kaliningrad / Barinova GM.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 226 Titre : Suivi du changement climatique sur la base d'observations phytophĆ©nologiques dans la rĆ©gion de Kaliningrad Titre original : Climate change monitoring on the basis of phytophenological observations in Kaliningrad region Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Barinova GM., Auteur ; Kokhanovskaya MI., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : changement climatique phĆ©nomĆØnes mĆ©tĆ©orologiques changements phytophĆ©nologiques plantes phĆ©noindicatrices Prusse orientale rĆ©gion de Kaliningrad RĆ©sumĆ© : La frĆ©quence des situations mĆ©tĆ©orologiques extrĆŖmes et des processus mĆ©tĆ©orologiques imprĆ©visibles Ć Kaliningrad (anciennement Kƶnigsberg, en Prusse orientale) est en augmentation sur une pĆ©riode de 30 ans. Les rĆ©sultats des observations phytophĆ©nologiques permettent de suivre le changement climatique rĆ©gional. Les donnĆ©es d'archives de la Prusse orientale (XIXe siĆØcle) ont Ć©tĆ© comparĆ©es aux rĆ©sultats issus de la recherche actuelle dans la rĆ©gion de Kaliningrad. Il est dĆ©montrĆ© que les changements phytophĆ©nologiques sont liĆ©s Ć des anomalies de tempĆ©rature lors des mois de printemps. En outre, certains problĆØmes de suivi phytophĆ©nologique au niveau rĆ©gional, comme la participation au projet scientifique, sont discutĆ©s. Pollution AtmosphĆ©rique, 226. Suivi du changement climatique sur la base d'observations phytophĆ©nologiques dans la rĆ©gion de Kaliningrad = Climate change monitoring on the basis of phytophenological observations in Kaliningrad region [texte imprimĆ©] / Barinova GM., Auteur ; Kokhanovskaya MI., Auteur . - 2015.
Tags : changement climatique phĆ©nomĆØnes mĆ©tĆ©orologiques changements phytophĆ©nologiques plantes phĆ©noindicatrices Prusse orientale rĆ©gion de Kaliningrad RĆ©sumĆ© : La frĆ©quence des situations mĆ©tĆ©orologiques extrĆŖmes et des processus mĆ©tĆ©orologiques imprĆ©visibles Ć Kaliningrad (anciennement Kƶnigsberg, en Prusse orientale) est en augmentation sur une pĆ©riode de 30 ans. Les rĆ©sultats des observations phytophĆ©nologiques permettent de suivre le changement climatique rĆ©gional. Les donnĆ©es d'archives de la Prusse orientale (XIXe siĆØcle) ont Ć©tĆ© comparĆ©es aux rĆ©sultats issus de la recherche actuelle dans la rĆ©gion de Kaliningrad. Il est dĆ©montrĆ© que les changements phytophĆ©nologiques sont liĆ©s Ć des anomalies de tempĆ©rature lors des mois de printemps. En outre, certains problĆØmes de suivi phytophĆ©nologique au niveau rĆ©gional, comme la participation au projet scientifique, sont discutĆ©s. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L226_BarinovaAdobe Acrobat PDF
Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 227 Titre : Agir pour le climat : un acte de foi ? Titre original : Acting for climate: a matter of faith ? Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Kopp M., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : climat engagement pour le climat religion justice climatique FĆ©dĆ©ration LuthĆ©rienne Mondiale acteurs religieux et spirituels COP 21 changements climatiques pratiques spirituelles RĆ©sumĆ© : Dans cet article sont explorĆ©s pour partie lā€™engagement pour le climat dā€™acteurs religieux et spirituels et ses fondements thĆ©ologiques. La visibilitĆ© rĆ©cente de cette action, notamment suite Ć la publication de lā€™encyclique Laudato Si du pape FranƧois et sa mĆ©diatisation planĆ©taire, est inversement proportionnelle Ć la connaissance quā€™en ont les sciences sociales. Du fait du caractĆØre largement inexplorĆ© du champ, lā€™article sā€™interdit tout propos gĆ©nĆ©ralisateur et propose plutĆ´t des coups de projecteurs dont lā€™orientation provient de la situation de lā€™auteur, lui-mĆŖme un acteur de terrain, chargĆ© de plaidoyer pour la justice climatique de la FĆ©dĆ©ration LuthĆ©rienne Mondiale. Il apparaĆ®t que, fondĆ©e dans la thĆ©ologie propre Ć chaque tradition, lā€™action dā€™acteurs religieux et spirituels est multiforme. Pour la COP-21 en particulier, des pratiques spirituelles millĆ©naires comme la priĆØre, le jeĆ»ne, le pĆØlerinage et la mĆ©ditation sont investies et adaptĆ©es au dĆ©fi posĆ© par les changements climatiques. Pollution AtmosphĆ©rique, 227. Agir pour le climat : un acte de foi ? = Acting for climate: a matter of faith ? [texte imprimĆ©] / Kopp M., Auteur . - 2015.
Tags : climat engagement pour le climat religion justice climatique FĆ©dĆ©ration LuthĆ©rienne Mondiale acteurs religieux et spirituels COP 21 changements climatiques pratiques spirituelles RĆ©sumĆ© : Dans cet article sont explorĆ©s pour partie lā€™engagement pour le climat dā€™acteurs religieux et spirituels et ses fondements thĆ©ologiques. La visibilitĆ© rĆ©cente de cette action, notamment suite Ć la publication de lā€™encyclique Laudato Si du pape FranƧois et sa mĆ©diatisation planĆ©taire, est inversement proportionnelle Ć la connaissance quā€™en ont les sciences sociales. Du fait du caractĆØre largement inexplorĆ© du champ, lā€™article sā€™interdit tout propos gĆ©nĆ©ralisateur et propose plutĆ´t des coups de projecteurs dont lā€™orientation provient de la situation de lā€™auteur, lui-mĆŖme un acteur de terrain, chargĆ© de plaidoyer pour la justice climatique de la FĆ©dĆ©ration LuthĆ©rienne Mondiale. Il apparaĆ®t que, fondĆ©e dans la thĆ©ologie propre Ć chaque tradition, lā€™action dā€™acteurs religieux et spirituels est multiforme. Pour la COP-21 en particulier, des pratiques spirituelles millĆ©naires comme la priĆØre, le jeĆ»ne, le pĆØlerinage et la mĆ©ditation sont investies et adaptĆ©es au dĆ©fi posĆ© par les changements climatiques. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L227_KoppAdobe Acrobat PDF
Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 227 Titre : Le changement climatique et les entreprises Titre original : Compagnies and climate change Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : I. Roussel, Auteur ; Tutenuit C., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : dĆ©carbonation innovation nouvelle Ć©conomie GIEC climat efficacitĆ© Ć©nergĆ©tique carbone GES transition Ć©nergĆ©tique RĆ©sumĆ© : En septembre 2014 Ć Lima (PĆ©rou), le secrĆ©taire gĆ©nĆ©ral des Nations unies, Ban Ki Moon, a invitĆ© la sociĆ©tĆ© civile Ć ĆŖtre partie prenante aux discussions sur le climat. Il visait en particulier les entreprises et a appelĆ© les gouvernements Ć prendre en compte leur point de vue. C'est en rĆ©ponse Ć cet appel qu'a Ć©tĆ© organisĆ© le Business & Climate Summit, Ć Paris, les 20 et 21 mai de cette annĆ©e. Les grandes entreprises mondiales ont rĆ©pondu Ā« prĆ©sent Ā» Ć cette sollicitation des Nations unies : 2 000 leaders Ć©conomiques et investisseurs ont, pendant deux jours, montrĆ© quā€™ils Ć©taient en capacitĆ© de peser dans des dĆ©cisions climatiques qui, selon eux, ne pourraient dĆ©boucher sur une dĆ©carbonation effective sans eux. Cependant, les entreprises montrent que par lā€™efficacitĆ© Ć©nergĆ©tique et lā€™innovation cette autre Ć©conomie est possible mais quā€™elle nĆ©cessite la collaboration de tous. Les Ɖtats doivent mettre en place un cadre rĆ©glementaire stable et donner des rĆØgles prĆ©cises pour lā€™Ć©valuation des GES et donner un prix au carbone. La collaboration Ć©troite entre les entreprises et lā€™Ć‰tat passe Ć©galement par un investissement des banques, des villes et des consommateurs. Les alertes Ć©mises par le GIEC sont entendues, mais lā€™adhĆ©sion de tous Ć une Ć©conomie verte pose de nombreux problĆØmes qui restent Ć rĆ©soudre pendant la pĆ©riode de la transition Ć©nergĆ©tique. Pollution AtmosphĆ©rique, 227. Le changement climatique et les entreprises = Compagnies and climate change [texte imprimĆ©] / I. Roussel, Auteur ; Tutenuit C., Auteur . - 2015.
Tags : dĆ©carbonation innovation nouvelle Ć©conomie GIEC climat efficacitĆ© Ć©nergĆ©tique carbone GES transition Ć©nergĆ©tique RĆ©sumĆ© : En septembre 2014 Ć Lima (PĆ©rou), le secrĆ©taire gĆ©nĆ©ral des Nations unies, Ban Ki Moon, a invitĆ© la sociĆ©tĆ© civile Ć ĆŖtre partie prenante aux discussions sur le climat. Il visait en particulier les entreprises et a appelĆ© les gouvernements Ć prendre en compte leur point de vue. C'est en rĆ©ponse Ć cet appel qu'a Ć©tĆ© organisĆ© le Business & Climate Summit, Ć Paris, les 20 et 21 mai de cette annĆ©e. Les grandes entreprises mondiales ont rĆ©pondu Ā« prĆ©sent Ā» Ć cette sollicitation des Nations unies : 2 000 leaders Ć©conomiques et investisseurs ont, pendant deux jours, montrĆ© quā€™ils Ć©taient en capacitĆ© de peser dans des dĆ©cisions climatiques qui, selon eux, ne pourraient dĆ©boucher sur une dĆ©carbonation effective sans eux. Cependant, les entreprises montrent que par lā€™efficacitĆ© Ć©nergĆ©tique et lā€™innovation cette autre Ć©conomie est possible mais quā€™elle nĆ©cessite la collaboration de tous. Les Ɖtats doivent mettre en place un cadre rĆ©glementaire stable et donner des rĆØgles prĆ©cises pour lā€™Ć©valuation des GES et donner un prix au carbone. La collaboration Ć©troite entre les entreprises et lā€™Ć‰tat passe Ć©galement par un investissement des banques, des villes et des consommateurs. Les alertes Ć©mises par le GIEC sont entendues, mais lā€™adhĆ©sion de tous Ć une Ć©conomie verte pose de nombreux problĆØmes qui restent Ć rĆ©soudre pendant la pĆ©riode de la transition Ć©nergĆ©tique. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L227_RousselAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 227. Comment les villes se positionnent-elles par rapport Ć la dynamique suscitĆ©e par le climat et la COP-21 ? ā€“ Entretien avec CĆ©lia Blauel et Jean-Patrick Masson / I. Roussel

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 227. Femmes, genre et changement climatique : lā€™exemple du WECF / L. Charles

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 227. ONG dans les COP : des Ā« outsiders Ā» de la politique climatique ? / Buffet C.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 227. Les petites Ć®les, sentinelles du dĆ©rĆØglement climatique / Beekmann M.

PermalinkPollution AtmosphƩrique, 227. Les variations rƩcentes du climat constatƩes au SƩnƩgal sont-elles en phase avec les descriptions donnƩes par les scƩnarios du GIEC ? / Sagna P.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 227. Vers une nouvelle gĆ©ographie de lā€™expertise climatique ? BCAS et ICCCAD, des expertises Ā« locales Ā» au Bangladesh / Buffet C.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 228. Une analyse statistique entre la concentration de particules fines et dā€™ozone en prĆ©sence de brume sĆØche dans le Sud du QuĆ©bec / ProvenƧal S.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 228. Ɖtude sociologique sur la pollution due au chauffage au bois dans lā€™agglomĆ©ration grenobloise : synthĆØse des principaux rĆ©sultats / La Branche S.

PermalinkPollution AtmosphƩrique, 228. Evaluation of lead pollution risk assessment in the air and dust (A case study: Shiraz-Fars) / E. Asrari

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 228. Indice de confinement de lā€™air intĆ©rieur : des Ć©coles aux logements / Riberon J

Permalink