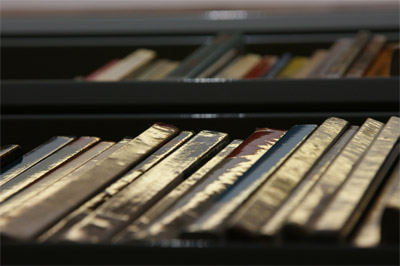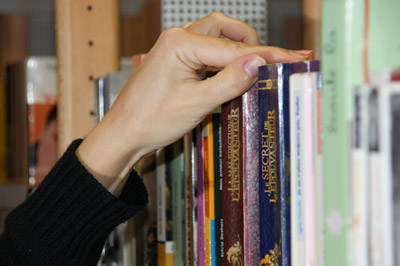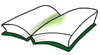Association pour la PrÃĐvention de la Pollution AtmosphÃĐrique
Revue Pollution AtmosphÃĐrique n°237-238 (Octobre 2018) â Habiter la ville



 Affiner la recherche
Affiner la recherchePollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Agriculture urbaine comme levier dâÃĐmancipation des femmes et de bien-Être en ville : lâexemple gennevillois / Faure E.

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238 Titre : Agriculture urbaine comme levier dâÃĐmancipation des femmes et de bien-Être en ville : lâexemple gennevillois Titre original : Urban agriculture as a lever for emancipation and well-being in the city: Gennevilliers example Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Faure E., Auteur ; Luxembourg, C., Auteur ; Dupont, A., Auteur AnnÃĐe de publication : 2018 Langues : Français (fre) Tags : agriculture urbaine, bien-Être, genre, jardins partagÃĐs RÃĐsumÃĐ : Cet article propose dâapprÃĐhender lâagriculture urbaine comme participant dâun projet collectif de dÃĐveloppement dâune ville nourriciÃĻre, respectueuse de lâenvironnement, support du bien-Être des individus, mais ÃĐgalement comme un levier potentiel dâÃĐmancipation des femmes.Notre propos sâappuie sur les rÃĐsultats dâune recherche-action en cours à Gennevilliers (Hauts-de-Seine, France). Nous mobilisons les rÃĐsultats dâobservations et dâentretiens semi-directifs menÃĐs auprÃĻs des principaux acteurs gennevillois impliquÃĐs dans le dÃĐveloppement de ces projets : personnes ÃĐlues, professionnelles locales, associations de mise en Åuvre et de gestion des jardins et leurs usagers et usagÃĻres. Une part importante des personnes rencontrÃĐes estime que venir au jardin ÂŦ leur fait du bien Âŧ. Les jardins gennevillois constituent ÃĐgalement des lieux de rencontre, des lieux (re)crÃĐateurs de liens sociaux de diffÃĐrentes natures. De plus, inscrits dans un modÃĻle social largement patriarcal, ces jardins apparaissent comme le support de rapports sociaux de genre inÃĐgalitaires. Cependant, à Gennevilliers, ces jardins, largement utilisÃĐs et gÃĐrÃĐs par des femmes, sont aussi le support dâune contestation, voire dâun renversement de certains stÃĐrÃĐotypes de genre. Ces espaces apparaissent comme des outils dâauto-formation, de partage de savoir-faire, dâestime de soi et de bien-Être entre femmes. Enfin, ces espaces constituent de vÃĐritables outils de construction de la ville (processus) dans lesquels (pour une fois) les femmes semblent avoir toute leur place. Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Agriculture urbaine comme levier dâÃĐmancipation des femmes et de bien-Être en ville : lâexemple gennevillois = Urban agriculture as a lever for emancipation and well-being in the city: Gennevilliers example [texte imprimÃĐ] / Faure E., Auteur ; Luxembourg, C., Auteur ; Dupont, A., Auteur . - 2018.
Langues : Français (fre)
Tags : agriculture urbaine, bien-Être, genre, jardins partagÃĐs RÃĐsumÃĐ : Cet article propose dâapprÃĐhender lâagriculture urbaine comme participant dâun projet collectif de dÃĐveloppement dâune ville nourriciÃĻre, respectueuse de lâenvironnement, support du bien-Être des individus, mais ÃĐgalement comme un levier potentiel dâÃĐmancipation des femmes.Notre propos sâappuie sur les rÃĐsultats dâune recherche-action en cours à Gennevilliers (Hauts-de-Seine, France). Nous mobilisons les rÃĐsultats dâobservations et dâentretiens semi-directifs menÃĐs auprÃĻs des principaux acteurs gennevillois impliquÃĐs dans le dÃĐveloppement de ces projets : personnes ÃĐlues, professionnelles locales, associations de mise en Åuvre et de gestion des jardins et leurs usagers et usagÃĻres. Une part importante des personnes rencontrÃĐes estime que venir au jardin ÂŦ leur fait du bien Âŧ. Les jardins gennevillois constituent ÃĐgalement des lieux de rencontre, des lieux (re)crÃĐateurs de liens sociaux de diffÃĐrentes natures. De plus, inscrits dans un modÃĻle social largement patriarcal, ces jardins apparaissent comme le support de rapports sociaux de genre inÃĐgalitaires. Cependant, à Gennevilliers, ces jardins, largement utilisÃĐs et gÃĐrÃĐs par des femmes, sont aussi le support dâune contestation, voire dâun renversement de certains stÃĐrÃĐotypes de genre. Ces espaces apparaissent comme des outils dâauto-formation, de partage de savoir-faire, dâestime de soi et de bien-Être entre femmes. Enfin, ces espaces constituent de vÃĐritables outils de construction de la ville (processus) dans lesquels (pour une fois) les femmes semblent avoir toute leur place. Exemplaires(0)
DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L237_23_Faure.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Air, climat, ÃĐnergie : convergences et contradictions à lâÃĐchelle urbaine. Lâexemple lyonnais / I. Roussel

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238 Titre : Air, climat, ÃĐnergie : convergences et contradictions à lâÃĐchelle urbaine. Lâexemple lyonnais Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : I. Roussel, Auteur ; Rocher, L., Auteur ; Aschan-Leygonie, C., Auteur AnnÃĐe de publication : 2018 Langues : Français (fre) Tags : climat urbain gaz à effet de serre pollution atmosphÃĐrique urbaine ÃĐnergies fossiles politiques publiques RÃĐsumÃĐ : Lâirruption du changement climatique se conjugue dans les villes avec la longue histoire, dÃĐbutÃĐe au temps de lâhygiÃĐnisme, de la lutte contre la pollution atmosphÃĐrique. La conjonction de ces deux thÃĻmes environnementaux bouleverse les savoir-faire des collectivitÃĐs locales urbaines, conduites à une gestion intÃĐgrÃĐe air/climat/ÃĐnergie. à travers lâexemple de lâagglomÃĐration lyonnaise, lâexamen de cette exigence montre quels sont les points de convergence et de vigilance auxquels les services de la mÃĐtropole sont confrontÃĐs. Que ce soit par la diminution des ÃĐnergies fossiles ou par la prise en compte des bÃĐnÃĐfices sanitaires dans les mesures dÃĐcrÃĐtÃĐes en faveur de la maÃŪtrise du climat, câest la santÃĐ et le bien-Être des habitants qui constituent le bÃĐnÃĐfice partagÃĐ souhaitÃĐ de ces politiques. Encore faut-il que, par lâintÃĐgration des diffÃĐrentes ÃĐchelles, ces bÃĐnÃĐfices soient rÃĐpartis ÃĐquitablement et quâils soient en phase avec les aspirations et la comprÃĐhension des habitants. Dans quelle mesure la mise en oeuvre dâun PCAET (Plan Climat-Air-Ãnergie Territoriaux), rendu obligatoire par la loi sur la transition ÃĐnergÃĐtique, permet-elle de rÃĐpondre à ces exigences ? Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Air, climat, ÃĐnergie : convergences et contradictions à lâÃĐchelle urbaine. Lâexemple lyonnais [texte imprimÃĐ] / I. Roussel, Auteur ; Rocher, L., Auteur ; Aschan-Leygonie, C., Auteur . - 2018.
Langues : Français (fre)
Tags : climat urbain gaz à effet de serre pollution atmosphÃĐrique urbaine ÃĐnergies fossiles politiques publiques RÃĐsumÃĐ : Lâirruption du changement climatique se conjugue dans les villes avec la longue histoire, dÃĐbutÃĐe au temps de lâhygiÃĐnisme, de la lutte contre la pollution atmosphÃĐrique. La conjonction de ces deux thÃĻmes environnementaux bouleverse les savoir-faire des collectivitÃĐs locales urbaines, conduites à une gestion intÃĐgrÃĐe air/climat/ÃĐnergie. à travers lâexemple de lâagglomÃĐration lyonnaise, lâexamen de cette exigence montre quels sont les points de convergence et de vigilance auxquels les services de la mÃĐtropole sont confrontÃĐs. Que ce soit par la diminution des ÃĐnergies fossiles ou par la prise en compte des bÃĐnÃĐfices sanitaires dans les mesures dÃĐcrÃĐtÃĐes en faveur de la maÃŪtrise du climat, câest la santÃĐ et le bien-Être des habitants qui constituent le bÃĐnÃĐfice partagÃĐ souhaitÃĐ de ces politiques. Encore faut-il que, par lâintÃĐgration des diffÃĐrentes ÃĐchelles, ces bÃĐnÃĐfices soient rÃĐpartis ÃĐquitablement et quâils soient en phase avec les aspirations et la comprÃĐhension des habitants. Dans quelle mesure la mise en oeuvre dâun PCAET (Plan Climat-Air-Ãnergie Territoriaux), rendu obligatoire par la loi sur la transition ÃĐnergÃĐtique, permet-elle de rÃĐpondre à ces exigences ? Exemplaires(0)
DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L237_12_Roussel.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Ce que lâÃĐvaluation des ÃĐcoquartiers nous apprend sur la ville durable : lâexemple du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ / Boissonade, J.

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238 Titre : Ce que lâÃĐvaluation des ÃĐcoquartiers nous apprend sur la ville durable : lâexemple du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ Titre original : What eco-districts assessment tells us about sustainable city: the âliving togetherâ example Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Boissonade, J., Auteur ; Valegeas, F., Auteur AnnÃĐe de publication : 2018 Langues : Français (fre) Tags : ÃĐcoquartier, ÃĐvaluation, indicateurs, ville durable, vivre-ensemble RÃĐsumÃĐ : Le ÂŦ vivre-ensemble Âŧ devient un enjeu central dans la production et la gestion de la ville durable. AprÃĻs avoir dÃĐpassÃĐ certaines contraintes techniques, la ville durable serait aujourdâhui confrontÃĐe à des limites, liÃĐes aux usages des habitants. Le mot dâordre du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ, largement mobilisÃĐ dans les opÃĐrations dâÃĐcoquartiers, serait alors une maniÃĻre dâengager une transformation des modes dâhabiter dans ces quartiers. Partant de lâobservation dâun dispositif de construction dâindicateurs ÃĐvaluatifs des ÃĐcoquartiers, cet article met à jour les dÃĐbats et paradoxes de la fabrique du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ. Les dÃĐbats analysÃĐs montrent que lâÃĐvaluation de lâhabiter dans ces ÃĐcoquartiers apparaÃŪt Être le fruit dâune tension entre :
- une dÃĐfinition a priori, qui sâappuie sur un modÃĻle idÃĐal du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ que lâÃĐvaluation viserait à confirmer ;
- des maniÃĻres de ÂŦ vivre-ensemble Âŧ construites par lâexpÃĐrience et les pratiques des acteurs : expÃĐriences que lâÃĐvaluation viserait à repÃĐrer et à interroger.
La conception dâun ÂŦ vivre-ensemble comme objectif Âŧ, portÃĐe par le ministÃĻre, nous paraÃŪt contradictoire avec sa volontÃĐ de donner les moyens aux porteurs dâÃĐcoquartiers dâassurer eux-mÊmes leur auto-ÃĐvaluation. Que peut nous apprendre alors lâanalyse des maniÃĻres de ÂŦ vivre-ensemble des expÃĐriences Âŧ sur la ville durable ? Une ville durable ÃĐtant elle aussi soumise à cette double injonction de performance et de dÃĐmocratie.Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Ce que lâÃĐvaluation des ÃĐcoquartiers nous apprend sur la ville durable : lâexemple du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ = What eco-districts assessment tells us about sustainable city: the âliving togetherâ example [texte imprimÃĐ] / Boissonade, J., Auteur ; Valegeas, F., Auteur . - 2018.
Langues : Français (fre)
Tags : ÃĐcoquartier, ÃĐvaluation, indicateurs, ville durable, vivre-ensemble RÃĐsumÃĐ : Le ÂŦ vivre-ensemble Âŧ devient un enjeu central dans la production et la gestion de la ville durable. AprÃĻs avoir dÃĐpassÃĐ certaines contraintes techniques, la ville durable serait aujourdâhui confrontÃĐe à des limites, liÃĐes aux usages des habitants. Le mot dâordre du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ, largement mobilisÃĐ dans les opÃĐrations dâÃĐcoquartiers, serait alors une maniÃĻre dâengager une transformation des modes dâhabiter dans ces quartiers. Partant de lâobservation dâun dispositif de construction dâindicateurs ÃĐvaluatifs des ÃĐcoquartiers, cet article met à jour les dÃĐbats et paradoxes de la fabrique du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ. Les dÃĐbats analysÃĐs montrent que lâÃĐvaluation de lâhabiter dans ces ÃĐcoquartiers apparaÃŪt Être le fruit dâune tension entre :
- une dÃĐfinition a priori, qui sâappuie sur un modÃĻle idÃĐal du ÂŦ vivre-ensemble Âŧ que lâÃĐvaluation viserait à confirmer ;
- des maniÃĻres de ÂŦ vivre-ensemble Âŧ construites par lâexpÃĐrience et les pratiques des acteurs : expÃĐriences que lâÃĐvaluation viserait à repÃĐrer et à interroger.
La conception dâun ÂŦ vivre-ensemble comme objectif Âŧ, portÃĐe par le ministÃĻre, nous paraÃŪt contradictoire avec sa volontÃĐ de donner les moyens aux porteurs dâÃĐcoquartiers dâassurer eux-mÊmes leur auto-ÃĐvaluation. Que peut nous apprendre alors lâanalyse des maniÃĻres de ÂŦ vivre-ensemble des expÃĐriences Âŧ sur la ville durable ? Une ville durable ÃĐtant elle aussi soumise à cette double injonction de performance et de dÃĐmocratie.Exemplaires(0)
DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L237_25_Boissonade-Valegeas.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Coexposition à la pollution atmosphÃĐrique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires / Piotrowski, A.

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238 Titre : Coexposition à la pollution atmosphÃĐrique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires Titre original : Co-exposure to air pollution and noise and cardiovascular diseases Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Piotrowski, A., Auteur ; Guillossou, G., Auteur ; Beaugrand, E., Auteur AnnÃĐe de publication : 2018 Langues : Français (fre) Tags : bruit pollution de lâair coexposition ville santÃĐ RÃĐsumÃĐ : Le trafic routier est, en ville, la premiÃĻre source de nuisances et de pollutions environnementales*, principal responsable de la pollution atmosphÃĐrique et du bruit. La population urbaine reprÃĐsente plus de la moitiÃĐ de la population mondiale, 78 % de la population des pays dÃĐveloppÃĐs, 86 % de la population française. Au vu de ces chiffres, il nâest pas surprenant que la pollution atmosphÃĐrique et le bruit soient les deux principaux facteurs de risque environnementaux et les deux principaux responsables de la charge (burden) de morbiditÃĐ environnementale en Europe. Il est ÃĐgalement reconnu que le bruit et la pollution atmosphÃĐrique sont, chacun, des facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires. Certes, les risques associÃĐs à ces deux facteurs considÃĐrÃĐs individuellement sont relativement faibles (dans ses calculs dâEnvironmental Burden of Disease, lâOrganisation Mondiale de la SantÃĐ a retenu des valeurs de risque relatif infÃĐrieures à 1,5), mais, à lâÃĐchelle des populations qui y sont exposÃĐes simultanÃĐment, durant leur vie entiÃĻre, ils posent un problÃĻme de santÃĐ publique de premier plan. Dâautant plus que les maladies cardio-vasculaires sont la premiÃĻre cause de mortalitÃĐ dans le monde, provoquant 17,3 millions de dÃĐcÃĻs chaque annÃĐe. Les effets sur la santÃĐ de lâexposition à la pollution atmosphÃĐrique ou au bruit sont ÃĐtudiÃĐs sÃĐparÃĐment depuis plus dâun demi-siÃĻcle, mais la rÃĐflexion sur leurs effets conjoints, en particulier sur les maladies cardio-vasculaires, ne date que du dÃĐbut des annÃĐes 2000. Elle est issue du constat suivant : le trafic routier ÃĐtant source à la fois de pollution et de bruit, ces deux facteurs ayant des effets cardio-vasculaires, il est trÃĻs probable que le bruit soit un facteur de confusion dans les ÃĐtudes sur les associations entre la pollution atmosphÃĐrique et les maladies cardio-vasculaires, et inversement. Or les possibles effets conjoints de cette coexposition nâÃĐtaient pas pris en compte dans les ÃĐtudes, jusquâà rÃĐcemment. Cette thÃĐmatique suscite lâintÃĐrÊt croissant des chercheurs et dâorganismes dÃĐcisionnels (par exemple, la Commission europÃĐenne). Mais le nombre restreint dâÃĐtudes publiÃĐes reste à souligner. La question principale ÃĐtant de savoir si ces effets passent par les mÊmes mÃĐcanismes dâaction et sâils sont synergiques. Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Coexposition à la pollution atmosphÃĐrique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires = Co-exposure to air pollution and noise and cardiovascular diseases [texte imprimÃĐ] / Piotrowski, A., Auteur ; Guillossou, G., Auteur ; Beaugrand, E., Auteur . - 2018.
Langues : Français (fre)
Tags : bruit pollution de lâair coexposition ville santÃĐ RÃĐsumÃĐ : Le trafic routier est, en ville, la premiÃĻre source de nuisances et de pollutions environnementales*, principal responsable de la pollution atmosphÃĐrique et du bruit. La population urbaine reprÃĐsente plus de la moitiÃĐ de la population mondiale, 78 % de la population des pays dÃĐveloppÃĐs, 86 % de la population française. Au vu de ces chiffres, il nâest pas surprenant que la pollution atmosphÃĐrique et le bruit soient les deux principaux facteurs de risque environnementaux et les deux principaux responsables de la charge (burden) de morbiditÃĐ environnementale en Europe. Il est ÃĐgalement reconnu que le bruit et la pollution atmosphÃĐrique sont, chacun, des facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires. Certes, les risques associÃĐs à ces deux facteurs considÃĐrÃĐs individuellement sont relativement faibles (dans ses calculs dâEnvironmental Burden of Disease, lâOrganisation Mondiale de la SantÃĐ a retenu des valeurs de risque relatif infÃĐrieures à 1,5), mais, à lâÃĐchelle des populations qui y sont exposÃĐes simultanÃĐment, durant leur vie entiÃĻre, ils posent un problÃĻme de santÃĐ publique de premier plan. Dâautant plus que les maladies cardio-vasculaires sont la premiÃĻre cause de mortalitÃĐ dans le monde, provoquant 17,3 millions de dÃĐcÃĻs chaque annÃĐe. Les effets sur la santÃĐ de lâexposition à la pollution atmosphÃĐrique ou au bruit sont ÃĐtudiÃĐs sÃĐparÃĐment depuis plus dâun demi-siÃĻcle, mais la rÃĐflexion sur leurs effets conjoints, en particulier sur les maladies cardio-vasculaires, ne date que du dÃĐbut des annÃĐes 2000. Elle est issue du constat suivant : le trafic routier ÃĐtant source à la fois de pollution et de bruit, ces deux facteurs ayant des effets cardio-vasculaires, il est trÃĻs probable que le bruit soit un facteur de confusion dans les ÃĐtudes sur les associations entre la pollution atmosphÃĐrique et les maladies cardio-vasculaires, et inversement. Or les possibles effets conjoints de cette coexposition nâÃĐtaient pas pris en compte dans les ÃĐtudes, jusquâà rÃĐcemment. Cette thÃĐmatique suscite lâintÃĐrÊt croissant des chercheurs et dâorganismes dÃĐcisionnels (par exemple, la Commission europÃĐenne). Mais le nombre restreint dâÃĐtudes publiÃĐes reste à souligner. La question principale ÃĐtant de savoir si ces effets passent par les mÊmes mÃĐcanismes dâaction et sâils sont synergiques. Exemplaires(0)
DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L237_10_Piotrowski.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Au-delà des restrictions de circulation : lâaccompagnement et lâinformation des villes / M. Pouponneau

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238 Titre : Au-delà des restrictions de circulation : lâaccompagnement et lâinformation des villes Titre original : Beyond traffic restriction: support and information provided by cities Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : M. Pouponneau, Auteur AnnÃĐe de publication : 2018 Langues : Français (fre) Tags : qualitÃĐ de lâair zone à faibles ÃĐmissions restriction de circulation accompagnement information communication RÃĐsumÃĐ : Les zones à faibles ÃĐmissions, ou Low Emission Zones (LEZ), sont des dispositifs de restriction de la circulation mis en oeuvre pour agir contre la pollution de lâair (plus spÃĐcifiquement contre les particules fines) liÃĐe au trafic routier. Que ce soit en France ou dans dâautres villes europÃĐennes, ce dispositif contraignant sâintÃĻgre dans un plan plus vaste de rÃĐduction de la pollution atmosphÃĐrique urbaine qui, le plus souvent, sâappuie sur lâamÃĐlioration de lâoffre de transports en commun. La population doit adhÃĐrer à cette transformation profonde de la ville en ÃĐtant mieux informÃĐe sur les mÃĐfaits de la pollution de lâair et sur les modalitÃĐs de restriction de la circulation proposÃĐe. La variÃĐtÃĐ des dispositifs dâaccompagnement est à lâimage de la diversitÃĐ des contextes urbains dans lesquels les LEZ sont implantÃĐes. La commission europÃĐenne finance le site internet (http://www.urbanaccessregulations.eu/) qui recense les diffÃĐrentes restrictions de circulation mises en place en Europe. Pollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Au-delà des restrictions de circulation : lâaccompagnement et lâinformation des villes = Beyond traffic restriction: support and information provided by cities [texte imprimÃĐ] / M. Pouponneau, Auteur . - 2018.
Langues : Français (fre)
Tags : qualitÃĐ de lâair zone à faibles ÃĐmissions restriction de circulation accompagnement information communication RÃĐsumÃĐ : Les zones à faibles ÃĐmissions, ou Low Emission Zones (LEZ), sont des dispositifs de restriction de la circulation mis en oeuvre pour agir contre la pollution de lâair (plus spÃĐcifiquement contre les particules fines) liÃĐe au trafic routier. Que ce soit en France ou dans dâautres villes europÃĐennes, ce dispositif contraignant sâintÃĻgre dans un plan plus vaste de rÃĐduction de la pollution atmosphÃĐrique urbaine qui, le plus souvent, sâappuie sur lâamÃĐlioration de lâoffre de transports en commun. La population doit adhÃĐrer à cette transformation profonde de la ville en ÃĐtant mieux informÃĐe sur les mÃĐfaits de la pollution de lâair et sur les modalitÃĐs de restriction de la circulation proposÃĐe. La variÃĐtÃĐ des dispositifs dâaccompagnement est à lâimage de la diversitÃĐ des contextes urbains dans lesquels les LEZ sont implantÃĐes. La commission europÃĐenne finance le site internet (http://www.urbanaccessregulations.eu/) qui recense les diffÃĐrentes restrictions de circulation mises en place en Europe. Exemplaires(0)
DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L237_11_Pouponneau_2.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. ForÊt de tours et changement dâÃĻre, une aspiration à la ville durable. Lâexemple de HanoÃŊ / H. J. Scarwell

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Habiter la ÂŦ ville durable Âŧ en logement social ? Une analyse sociologique de la transition ÃĐnergÃĐtique à lâÃĐchelle locale / P. Hamman

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. ModÃĐlisation de lâexposition en zone urbaine : les limites dâune approche techniciste, un nÃĐcessaire couplage entre avancÃĐes technologiques et comportement des individus / Coll, I.

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Quand lâÃĐcologisation des logements impacte la santÃĐ des habitants. Confort domestique et qualitÃĐ de lâair intÃĐrieur en conflit / ZÃĐlem, M.C.

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Le retour de la mobilitÃĐ active en Chine ? Le rÃīle des espaces publics à Shanghai / Tan, L.

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. La santÃĐ au cÅur des projets dâurbanisme : lâÃvaluation dâImpact sur la SantÃĐ (EIS) / Anvizino, L.

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Les services de mobilitÃĐ partagÃĐs peuventils aider la mÃĐtropole lilloise à amÃĐliorer la qualitÃĐ de lâair ? / FrÃĻre, S.

PermalinkPollution AtmosphÃĐrique, 237-238. Lâurbanisation du monde : lâhÃĐtÃĐrogÃĐnÃĐitÃĐ du fait urbain et lâavÃĻnement de la mÃĐtropole / Ghorra-Gobin, C.

Permalink