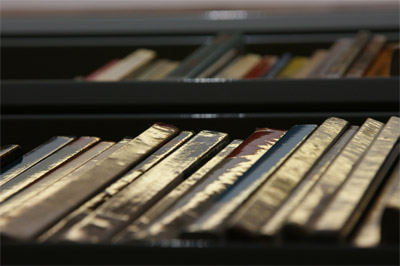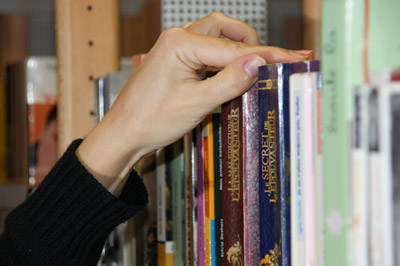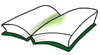Association pour la PrƩvention de la Pollution AtmosphƩrique
RĆ©sultat de la recherche
6 recherche sur le tag
'pollution de l’air' 



 Affiner la recherche GƩnƩrer le flux rss de la recherche
Partager le rƩsultat de cette recherche
Affiner la recherche GƩnƩrer le flux rss de la recherche
Partager le rĆ©sultat de cette recherchePollution AtmosphĆ©rique, 233. Les enjeux de la pollution de lā€™air en France : dĆ©laissement ou droit en jeu(x) / H. J. Scarwell

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 233 Titre : Les enjeux de la pollution de lā€™air en France : dĆ©laissement ou droit en jeu(x) Titre original : The stakes of air pollution in France: absence-presence of the law-maker Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : H. J. Scarwell, Auteur AnnĆ©e de publication : 2017 Tags : action publique droit de lā€™environnement europĆ©en pollution de lā€™air rĆ©gulation santĆ© publique stratĆ©gie et rĆ´le du droit RĆ©sumĆ© : En France, des voiles de pollution recouvrent rĆ©guliĆØrement les grandes villes. Les mĆ©dias relatent quotidiennement le renouvellement de pics de pollution et le dĆ©passement des seuils dā€™alerte, et les attribuent aux particules fines et aux poussiĆØres de compositions diverses en suspension dans lā€™atmosphĆØre (chauffage au bois et au fioul, industrie, moteurs surtout diesel en ville). Aussi, les mesures adoptĆ©es pour lutter contre cette pollution ne seraient-elles pas des mesures en trompe-lā€™Å“il occultant des Ā« blocages Ā», des incohĆ©rences ou le recours Ć des pratiques et Ć des techniques de nĆ©gociations des normes ? Pollution AtmosphĆ©rique, 233. Les enjeux de la pollution de lā€™air en France : dĆ©laissement ou droit en jeu(x) = The stakes of air pollution in France: absence-presence of the law-maker [texte imprimĆ©] / H. J. Scarwell, Auteur . - 2017.
Tags : action publique droit de lā€™environnement europĆ©en pollution de lā€™air rĆ©gulation santĆ© publique stratĆ©gie et rĆ´le du droit RĆ©sumĆ© : En France, des voiles de pollution recouvrent rĆ©guliĆØrement les grandes villes. Les mĆ©dias relatent quotidiennement le renouvellement de pics de pollution et le dĆ©passement des seuils dā€™alerte, et les attribuent aux particules fines et aux poussiĆØres de compositions diverses en suspension dans lā€™atmosphĆØre (chauffage au bois et au fioul, industrie, moteurs surtout diesel en ville). Aussi, les mesures adoptĆ©es pour lutter contre cette pollution ne seraient-elles pas des mesures en trompe-lā€™Å“il occultant des Ā« blocages Ā», des incohĆ©rences ou le recours Ć des pratiques et Ć des techniques de nĆ©gociations des normes ? Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L233_ScarwellAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 235. Aide aux dĆ©cideurs - Ɖvaluation des coĆ»ts et des bĆ©nĆ©fices sanitaires de politiques de lutte contre la pollution de lā€™air / Schucht S.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 235 Titre : Aide aux dĆ©cideurs - Ɖvaluation des coĆ»ts et des bĆ©nĆ©fices sanitaires de politiques de lutte contre la pollution de lā€™air Titre original : Support to Decision Makers ā€“ Evaluation of Costs and Health Benefits Associated to Air Pollution Control Policies Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Schucht S., Auteur ; Colette A., Auteur ; J. M. Brignon, Auteur ; B. Bessagnet, Auteur ; RouĆÆl L., Auteur AnnĆ©e de publication : 2017 Tags : analyse coĆ»ts/bĆ©nĆ©fices analyse de scĆ©narios analyse dā€™impacts sanitaires changement climatique coĆ»ts sanitaires modĆ©lisation atmosphĆ©rique pollution de lā€™air qualitĆ© de lā€™air RĆ©sumĆ© : Une chaĆ®ne de modĆØles intĆ©grĆ©s a Ć©tĆ© mise en Å“uvre Ć lā€™INERIS, qui permet dā€™Ć©valuer des politiques de lutte contre la pollution atmosphĆ©rique en termes de coĆ»ts des actions, de leurs effets sur la qualitĆ© de lā€™air et des bĆ©nĆ©fices sanitaires associĆ©s. Elle permet de quantifier puis monĆ©tiser ces effets sanitaires, aussi bien des mesures individuelles de rĆ©duction des Ć©missions atmosphĆ©riques que des scĆ©narios (jeux de mesures complexes) de mise en Å“uvre de politiques publiques, et de tenir compte de lā€™impact du changement climatique sur la qualitĆ© de lā€™air.
Lā€™article prĆ©sente briĆØvement cette chaĆ®ne de modĆØles et illustre ses domaines dā€™applications sur la base dā€™exemples dā€™Ć©tudes rĆ©centes dā€™appui aux pouvoirs publics et de projets de recherche.
Les rĆ©sultats de ces Ć©tudes montrent que beaucoup dā€™actions pour amĆ©liorer la qualitĆ© de lā€™air actuellement envisagĆ©es permettent dā€™obtenir des bĆ©nĆ©fices pour la santĆ©, dont la valeur monĆ©taire dĆ©passe largement les coĆ»ts des politiques. Ils illustrent aussi les avantages dā€™une coopĆ©ration internationale dans la lutte contre la pollution de lā€™air.Pollution AtmosphĆ©rique, 235. Aide aux dĆ©cideurs - Ɖvaluation des coĆ»ts et des bĆ©nĆ©fices sanitaires de politiques de lutte contre la pollution de lā€™air = Support to Decision Makers ā€“ Evaluation of Costs and Health Benefits Associated to Air Pollution Control Policies [texte imprimĆ©] / Schucht S., Auteur ; Colette A., Auteur ; J. M. Brignon, Auteur ; B. Bessagnet, Auteur ; RouĆÆl L., Auteur . - 2017.
Tags : analyse coĆ»ts/bĆ©nĆ©fices analyse de scĆ©narios analyse dā€™impacts sanitaires changement climatique coĆ»ts sanitaires modĆ©lisation atmosphĆ©rique pollution de lā€™air qualitĆ© de lā€™air RĆ©sumĆ© : Une chaĆ®ne de modĆØles intĆ©grĆ©s a Ć©tĆ© mise en Å“uvre Ć lā€™INERIS, qui permet dā€™Ć©valuer des politiques de lutte contre la pollution atmosphĆ©rique en termes de coĆ»ts des actions, de leurs effets sur la qualitĆ© de lā€™air et des bĆ©nĆ©fices sanitaires associĆ©s. Elle permet de quantifier puis monĆ©tiser ces effets sanitaires, aussi bien des mesures individuelles de rĆ©duction des Ć©missions atmosphĆ©riques que des scĆ©narios (jeux de mesures complexes) de mise en Å“uvre de politiques publiques, et de tenir compte de lā€™impact du changement climatique sur la qualitĆ© de lā€™air.
Lā€™article prĆ©sente briĆØvement cette chaĆ®ne de modĆØles et illustre ses domaines dā€™applications sur la base dā€™exemples dā€™Ć©tudes rĆ©centes dā€™appui aux pouvoirs publics et de projets de recherche.
Les rĆ©sultats de ces Ć©tudes montrent que beaucoup dā€™actions pour amĆ©liorer la qualitĆ© de lā€™air actuellement envisagĆ©es permettent dā€™obtenir des bĆ©nĆ©fices pour la santĆ©, dont la valeur monĆ©taire dĆ©passe largement les coĆ»ts des politiques. Ils illustrent aussi les avantages dā€™une coopĆ©ration internationale dans la lutte contre la pollution de lā€™air.Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L235_Schucht.pdfAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 235. Quantification de lā€™impact sanitaire des mesures de rĆ©duction de la pollution atmosphĆ©rique : apport de la littĆ©rature scientifique / S. Host

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 235 Titre : Quantification de lā€™impact sanitaire des mesures de rĆ©duction de la pollution atmosphĆ©rique : apport de la littĆ©rature scientifique Titre original : Health impact assessment of air quality improvement strategies: quantifying methods Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : S. Host, Auteur ; Duchesne L., Auteur AnnĆ©e de publication : 2017 Tags : Ć©valuation quantitative dā€™impact sanitaire intervention pollution de lā€™air synthĆØse bibliographique RĆ©sumĆ© : Les Ɖvaluations Quantitatives dā€™Impact Sanitaire (EQIS) peuvent permettre de quantifier les bĆ©nĆ©fices sanitaires dā€™actions de rĆ©duction de la pollution atmosphĆ©rique. Elles prĆ©sentent notamment lā€™intĆ©rĆŖt de pouvoir estimer lā€™impact futur de projets dā€™action ou dā€™actions en cours de mise en Å“uvre. Cet article dĆ©crit les rĆ©sultats de 16 EQIS visant Ć amĆ©liorer la qualitĆ© de lā€™air ambiant, recensĆ©es dans la littĆ©rature scientifique jusquā€™en 2015, et fournit une illustration de nombreux cas dā€™application de cette approche. Lā€™analyse des Ć©lĆ©ments mĆ©thodologiques qui peuvent diffĆ©rer selon la nature de lā€™intervention, le contexte de lā€™Ć©valuation et la disponibilitĆ© des donnĆ©es permet dā€™appuyer la rĆ©alisation dā€™EQIS dā€™intervention qui ont pour vocation dā€™accompagner les dĆ©cisions. Les rĆ©sultats de ces Ć©tudes, pour la plupart encourageants, confortent et encouragent les mesures mises en Å“uvre ou Ć mettre en Å“uvre. Pollution AtmosphĆ©rique, 235. Quantification de lā€™impact sanitaire des mesures de rĆ©duction de la pollution atmosphĆ©rique : apport de la littĆ©rature scientifique = Health impact assessment of air quality improvement strategies: quantifying methods [texte imprimĆ©] / S. Host, Auteur ; Duchesne L., Auteur . - 2017.
Tags : Ć©valuation quantitative dā€™impact sanitaire intervention pollution de lā€™air synthĆØse bibliographique RĆ©sumĆ© : Les Ɖvaluations Quantitatives dā€™Impact Sanitaire (EQIS) peuvent permettre de quantifier les bĆ©nĆ©fices sanitaires dā€™actions de rĆ©duction de la pollution atmosphĆ©rique. Elles prĆ©sentent notamment lā€™intĆ©rĆŖt de pouvoir estimer lā€™impact futur de projets dā€™action ou dā€™actions en cours de mise en Å“uvre. Cet article dĆ©crit les rĆ©sultats de 16 EQIS visant Ć amĆ©liorer la qualitĆ© de lā€™air ambiant, recensĆ©es dans la littĆ©rature scientifique jusquā€™en 2015, et fournit une illustration de nombreux cas dā€™application de cette approche. Lā€™analyse des Ć©lĆ©ments mĆ©thodologiques qui peuvent diffĆ©rer selon la nature de lā€™intervention, le contexte de lā€™Ć©valuation et la disponibilitĆ© des donnĆ©es permet dā€™appuyer la rĆ©alisation dā€™EQIS dā€™intervention qui ont pour vocation dā€™accompagner les dĆ©cisions. Les rĆ©sultats de ces Ć©tudes, pour la plupart encourageants, confortent et encouragent les mesures mises en Å“uvre ou Ć mettre en Å“uvre. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L235_Host_DuchesneAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 237-238. Coexposition Ć la pollution atmosphĆ©rique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires / Piotrowski, A.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 237-238 Titre : Coexposition Ć la pollution atmosphĆ©rique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires Titre original : Co-exposure to air pollution and noise and cardiovascular diseases Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Piotrowski, A., Auteur ; Guillossou, G., Auteur ; Beaugrand, E., Auteur AnnĆ©e de publication : 2018 Langues : FranƧais (fre) Tags : bruit pollution de lā€™air coexposition ville santĆ© RĆ©sumĆ© : Le trafic routier est, en ville, la premiĆØre source de nuisances et de pollutions environnementales*, principal responsable de la pollution atmosphĆ©rique et du bruit. La population urbaine reprĆ©sente plus de la moitiĆ© de la population mondiale, 78 % de la population des pays dĆ©veloppĆ©s, 86 % de la population franƧaise. Au vu de ces chiffres, il nā€™est pas surprenant que la pollution atmosphĆ©rique et le bruit soient les deux principaux facteurs de risque environnementaux et les deux principaux responsables de la charge (burden) de morbiditĆ© environnementale en Europe. Il est Ć©galement reconnu que le bruit et la pollution atmosphĆ©rique sont, chacun, des facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires. Certes, les risques associĆ©s Ć ces deux facteurs considĆ©rĆ©s individuellement sont relativement faibles (dans ses calculs dā€™Environmental Burden of Disease, lā€™Organisation Mondiale de la SantĆ© a retenu des valeurs de risque relatif infĆ©rieures Ć 1,5), mais, Ć lā€™Ć©chelle des populations qui y sont exposĆ©es simultanĆ©ment, durant leur vie entiĆØre, ils posent un problĆØme de santĆ© publique de premier plan. Dā€™autant plus que les maladies cardio-vasculaires sont la premiĆØre cause de mortalitĆ© dans le monde, provoquant 17,3 millions de dĆ©cĆØs chaque annĆ©e. Les effets sur la santĆ© de lā€™exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique ou au bruit sont Ć©tudiĆ©s sĆ©parĆ©ment depuis plus dā€™un demi-siĆØcle, mais la rĆ©flexion sur leurs effets conjoints, en particulier sur les maladies cardio-vasculaires, ne date que du dĆ©but des annĆ©es 2000. Elle est issue du constat suivant : le trafic routier Ć©tant source Ć la fois de pollution et de bruit, ces deux facteurs ayant des effets cardio-vasculaires, il est trĆØs probable que le bruit soit un facteur de confusion dans les Ć©tudes sur les associations entre la pollution atmosphĆ©rique et les maladies cardio-vasculaires, et inversement. Or les possibles effets conjoints de cette coexposition nā€™Ć©taient pas pris en compte dans les Ć©tudes, jusquā€™Ć rĆ©cemment. Cette thĆ©matique suscite lā€™intĆ©rĆŖt croissant des chercheurs et dā€™organismes dĆ©cisionnels (par exemple, la Commission europĆ©enne). Mais le nombre restreint dā€™Ć©tudes publiĆ©es reste Ć souligner. La question principale Ć©tant de savoir si ces effets passent par les mĆŖmes mĆ©canismes dā€™action et sā€™ils sont synergiques. Pollution AtmosphĆ©rique, 237-238. Coexposition Ć la pollution atmosphĆ©rique et au bruit, et maladies cardio-vasculaires = Co-exposure to air pollution and noise and cardiovascular diseases [texte imprimĆ©] / Piotrowski, A., Auteur ; Guillossou, G., Auteur ; Beaugrand, E., Auteur . - 2018.
Langues : FranƧais (fre)
Tags : bruit pollution de lā€™air coexposition ville santĆ© RĆ©sumĆ© : Le trafic routier est, en ville, la premiĆØre source de nuisances et de pollutions environnementales*, principal responsable de la pollution atmosphĆ©rique et du bruit. La population urbaine reprĆ©sente plus de la moitiĆ© de la population mondiale, 78 % de la population des pays dĆ©veloppĆ©s, 86 % de la population franƧaise. Au vu de ces chiffres, il nā€™est pas surprenant que la pollution atmosphĆ©rique et le bruit soient les deux principaux facteurs de risque environnementaux et les deux principaux responsables de la charge (burden) de morbiditĆ© environnementale en Europe. Il est Ć©galement reconnu que le bruit et la pollution atmosphĆ©rique sont, chacun, des facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires. Certes, les risques associĆ©s Ć ces deux facteurs considĆ©rĆ©s individuellement sont relativement faibles (dans ses calculs dā€™Environmental Burden of Disease, lā€™Organisation Mondiale de la SantĆ© a retenu des valeurs de risque relatif infĆ©rieures Ć 1,5), mais, Ć lā€™Ć©chelle des populations qui y sont exposĆ©es simultanĆ©ment, durant leur vie entiĆØre, ils posent un problĆØme de santĆ© publique de premier plan. Dā€™autant plus que les maladies cardio-vasculaires sont la premiĆØre cause de mortalitĆ© dans le monde, provoquant 17,3 millions de dĆ©cĆØs chaque annĆ©e. Les effets sur la santĆ© de lā€™exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique ou au bruit sont Ć©tudiĆ©s sĆ©parĆ©ment depuis plus dā€™un demi-siĆØcle, mais la rĆ©flexion sur leurs effets conjoints, en particulier sur les maladies cardio-vasculaires, ne date que du dĆ©but des annĆ©es 2000. Elle est issue du constat suivant : le trafic routier Ć©tant source Ć la fois de pollution et de bruit, ces deux facteurs ayant des effets cardio-vasculaires, il est trĆØs probable que le bruit soit un facteur de confusion dans les Ć©tudes sur les associations entre la pollution atmosphĆ©rique et les maladies cardio-vasculaires, et inversement. Or les possibles effets conjoints de cette coexposition nā€™Ć©taient pas pris en compte dans les Ć©tudes, jusquā€™Ć rĆ©cemment. Cette thĆ©matique suscite lā€™intĆ©rĆŖt croissant des chercheurs et dā€™organismes dĆ©cisionnels (par exemple, la Commission europĆ©enne). Mais le nombre restreint dā€™Ć©tudes publiĆ©es reste Ć souligner. La question principale Ć©tant de savoir si ces effets passent par les mĆŖmes mĆ©canismes dā€™action et sā€™ils sont synergiques. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L237_10_Piotrowski.pdfAdobe Acrobat PDF
Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 231-232 Titre : GĀ²AME - Grand GenĆØve Air ModĆØle Ɖmissions Titre original : GĀ²AME - Grand GenĆØve Air Model Emissions Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Brulfert G., Auteur ; Chapuis D., Auteur ; Royer P., Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : Ć©missions modĆ©lisation pollution de lā€™air programme INTERREG IV zone frontaliĆØre RĆ©sumĆ© : Avec presque 1 million dā€™habitants sur le Grand GenĆØve, lā€™amĆ©lioration de la qualitĆ© de lā€™air constitue un enjeu sanitaire important, tout autant quā€™une attente forte des populations. Ce constat est largement partagĆ© entre la France et la ConfĆ©dĆ©ration helvĆ©tique. Les actions des uns ayant des rĆ©percussions sur la qualitĆ© de lā€™air respirĆ© par les autres, il est par consĆ©quent indispensable quā€™il existe une vision partagĆ©e, des outils communs puis une gestion coordonnĆ©e de la qualitĆ© de lā€™air Ć lā€™Ć©chelle des 212 communes de lā€™espace franco-suisse quā€™est le Grand GenĆØve.
Les Ć©lĆ©ments du premier diagnostic de la qualitĆ© de lā€™air sur le Grand GenĆØve Ć©tabli en 2012 ont mis en Ć©vidence certains points de vigilance comme le centre-ville et lā€™aĆ©roport de GenĆØve, ainsi que les secteurs rĆ©sidentiels. La rĆ©gion RhĆ´ne-Alpes est concernĆ©e par des dĆ©passements rĆ©guliers des normes de qualitĆ© de lā€™air dĆ©finies au niveau europĆ©en. Parmi les secteurs qui posent problĆØme figure lā€™agglomĆ©ration dā€™Annemasse, avec des dĆ©passements enregistrĆ©s en poussiĆØres fines. Cette agglomĆ©ration est situĆ©e entre deux zones particuliĆØrement concernĆ©es par la pollution atmosphĆ©rique : dā€™un cĆ´tĆ©, le bassin genevois et, de lā€™autre, la vallĆ©e de lā€™Arve, faisant actuellement lā€™objet dā€™un Plan de Protection de lā€™AtmosphĆØre (dont certaines communes font partie du Grand GenĆØve).
Lā€™objectif du projet GĀ²AME (Grand GenĆØve Air ModĆØle Ɖmission) a Ć©tĆ© de produire un outil commun et harmonisĆ© de diagnostic et dā€™aide Ć lā€™Ć©tablissement dā€™un plan dā€™actions Ć lā€™Ć©chelle du Grand GenĆØve. Cet outil a permis de mieux connaĆ®tre les Ć©missions de polluants du territoire transfrontalier, de travailler de maniĆØre prospective en identifiant les secteurs les plus Ć©metteurs et de tester lā€™Ć©valuation dā€™actions dā€™amĆ©nagement du territoire, dā€™infrastructure ou dā€™action dā€™amĆ©lioration de la qualitĆ© de lā€™air.
Ainsi, le programme Ć©laborĆ© sur 2 ans, de juin 2013 Ć lā€™Ć©tĆ© 2015, a permis :
- la mise en cohĆ©rence des inventaires dā€™Ć©missions en situation actuelle : cette action a permis de cartographier de part et dā€™autre de la frontiĆØre les sources et polluants, et dā€™estimer quantitativement les diffĆ©rentes sources dā€™Ć©missions du bassin. Ainsi, ce travail a permis de mettre en Ć©vidence les diffĆ©rences de parc roulant entre les pays, la prĆ©dominance des Ć©missions de PM10 du secteur rĆ©sidentiel cĆ´tĆ© franƧais, lā€™importance des Ć©missions dā€™oxydes dā€™azote de GenĆØve et de la zone aĆ©roportuaire ;
- le dĆ©veloppement dā€™un modĆØle transfrontalier commun pour la cartographie de la qualitĆ© de lā€™air et lā€™Ć©tude des scĆ©narios : ce modĆØle numĆ©rique permet de cartographier les concentrations et les dĆ©passements de normes de la qualitĆ© de lā€™air sur le bassin (selon les normes en vigueur dans chaque pays). Ce modĆØle permet Ć la fois un calcul de la pollution de fond rĆ©gional par WRF/ChimĆØre en prenant en compte lā€™ensemble des stations de mesures franƧaises et suisses puis un calcul Ć lā€™Ć©chelle de la rue sur lā€™ensemble du rĆ©seau routier, Ć lā€™aide du modĆØle SIRANE ;
- le calcul prospectif de scenarios dā€™Ć©missions : cette action a permis dā€™Ć©laborer des scĆ©narios rĆ©alistes Ć lā€™Ć©chĆ©ance 2020 et 2030, afin de cartographier et estimer lā€™Ć©volution des Ć©missions et des concentrations associĆ©es, ainsi que les populations impactĆ©es Ć ces Ć©chĆ©ances (entre 50 et 75 % de la population encore impactĆ©e sur le Grand GenĆØve pour les PM10, suivant les normes suisses actuelles en 2030).
GĀ²AME est une opĆ©ration rĆ©alisĆ©e dans le cadre du programme de coopĆ©ration territoriale europĆ©enne INTERREG IV A France-Suisse 2007-2013.Pollution AtmosphĆ©rique, 231-232. GĀ²AME - Grand GenĆØve Air ModĆØle Ɖmissions = GĀ²AME - Grand GenĆØve Air Model Emissions [texte imprimĆ©] / Brulfert G., Auteur ; Chapuis D., Auteur ; Royer P., Auteur . - 2016.
Tags : Ć©missions modĆ©lisation pollution de lā€™air programme INTERREG IV zone frontaliĆØre RĆ©sumĆ© : Avec presque 1 million dā€™habitants sur le Grand GenĆØve, lā€™amĆ©lioration de la qualitĆ© de lā€™air constitue un enjeu sanitaire important, tout autant quā€™une attente forte des populations. Ce constat est largement partagĆ© entre la France et la ConfĆ©dĆ©ration helvĆ©tique. Les actions des uns ayant des rĆ©percussions sur la qualitĆ© de lā€™air respirĆ© par les autres, il est par consĆ©quent indispensable quā€™il existe une vision partagĆ©e, des outils communs puis une gestion coordonnĆ©e de la qualitĆ© de lā€™air Ć lā€™Ć©chelle des 212 communes de lā€™espace franco-suisse quā€™est le Grand GenĆØve.
Les Ć©lĆ©ments du premier diagnostic de la qualitĆ© de lā€™air sur le Grand GenĆØve Ć©tabli en 2012 ont mis en Ć©vidence certains points de vigilance comme le centre-ville et lā€™aĆ©roport de GenĆØve, ainsi que les secteurs rĆ©sidentiels. La rĆ©gion RhĆ´ne-Alpes est concernĆ©e par des dĆ©passements rĆ©guliers des normes de qualitĆ© de lā€™air dĆ©finies au niveau europĆ©en. Parmi les secteurs qui posent problĆØme figure lā€™agglomĆ©ration dā€™Annemasse, avec des dĆ©passements enregistrĆ©s en poussiĆØres fines. Cette agglomĆ©ration est situĆ©e entre deux zones particuliĆØrement concernĆ©es par la pollution atmosphĆ©rique : dā€™un cĆ´tĆ©, le bassin genevois et, de lā€™autre, la vallĆ©e de lā€™Arve, faisant actuellement lā€™objet dā€™un Plan de Protection de lā€™AtmosphĆØre (dont certaines communes font partie du Grand GenĆØve).
Lā€™objectif du projet GĀ²AME (Grand GenĆØve Air ModĆØle Ɖmission) a Ć©tĆ© de produire un outil commun et harmonisĆ© de diagnostic et dā€™aide Ć lā€™Ć©tablissement dā€™un plan dā€™actions Ć lā€™Ć©chelle du Grand GenĆØve. Cet outil a permis de mieux connaĆ®tre les Ć©missions de polluants du territoire transfrontalier, de travailler de maniĆØre prospective en identifiant les secteurs les plus Ć©metteurs et de tester lā€™Ć©valuation dā€™actions dā€™amĆ©nagement du territoire, dā€™infrastructure ou dā€™action dā€™amĆ©lioration de la qualitĆ© de lā€™air.
Ainsi, le programme Ć©laborĆ© sur 2 ans, de juin 2013 Ć lā€™Ć©tĆ© 2015, a permis :
- la mise en cohĆ©rence des inventaires dā€™Ć©missions en situation actuelle : cette action a permis de cartographier de part et dā€™autre de la frontiĆØre les sources et polluants, et dā€™estimer quantitativement les diffĆ©rentes sources dā€™Ć©missions du bassin. Ainsi, ce travail a permis de mettre en Ć©vidence les diffĆ©rences de parc roulant entre les pays, la prĆ©dominance des Ć©missions de PM10 du secteur rĆ©sidentiel cĆ´tĆ© franƧais, lā€™importance des Ć©missions dā€™oxydes dā€™azote de GenĆØve et de la zone aĆ©roportuaire ;
- le dĆ©veloppement dā€™un modĆØle transfrontalier commun pour la cartographie de la qualitĆ© de lā€™air et lā€™Ć©tude des scĆ©narios : ce modĆØle numĆ©rique permet de cartographier les concentrations et les dĆ©passements de normes de la qualitĆ© de lā€™air sur le bassin (selon les normes en vigueur dans chaque pays). Ce modĆØle permet Ć la fois un calcul de la pollution de fond rĆ©gional par WRF/ChimĆØre en prenant en compte lā€™ensemble des stations de mesures franƧaises et suisses puis un calcul Ć lā€™Ć©chelle de la rue sur lā€™ensemble du rĆ©seau routier, Ć lā€™aide du modĆØle SIRANE ;
- le calcul prospectif de scenarios dā€™Ć©missions : cette action a permis dā€™Ć©laborer des scĆ©narios rĆ©alistes Ć lā€™Ć©chĆ©ance 2020 et 2030, afin de cartographier et estimer lā€™Ć©volution des Ć©missions et des concentrations associĆ©es, ainsi que les populations impactĆ©es Ć ces Ć©chĆ©ances (entre 50 et 75 % de la population encore impactĆ©e sur le Grand GenĆØve pour les PM10, suivant les normes suisses actuelles en 2030).
GĀ²AME est une opĆ©ration rĆ©alisĆ©e dans le cadre du programme de coopĆ©ration territoriale europĆ©enne INTERREG IV A France-Suisse 2007-2013.Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L232_BrulfertAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphƩrique, 235. Ɖvaluation a priori et suivi au fil du temps des impacts des politiques locales de rƩduction des Ʃmissions de polluants atmosphƩriques / C. HonorƩ

Permalink