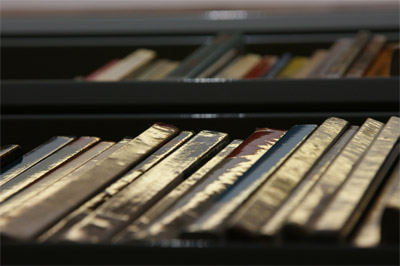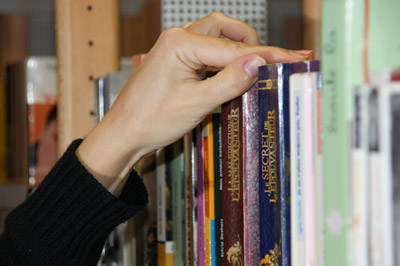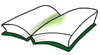Association pour la PrÃĐvention de la Pollution AtmosphÃĐrique
Revue Pollution AtmosphÃĐrique n°233 (Janvier-Mars 2017)



 Affiner la recherche
Affiner la recherchePollution AtmosphÃĐrique, 233. Les enjeux de la pollution de lâair en France : dÃĐlaissement ou droit en jeu(x) / H. J. Scarwell

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 233 Titre : Les enjeux de la pollution de lâair en France : dÃĐlaissement ou droit en jeu(x) Titre original : The stakes of air pollution in France: absence-presence of the law-maker Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : H. J. Scarwell, Auteur AnnÃĐe de publication : 2017 Tags : action publique droit de lâenvironnement europÃĐen pollution de lâair rÃĐgulation santÃĐ publique stratÃĐgie et rÃīle du droit RÃĐsumÃĐ : En France, des voiles de pollution recouvrent rÃĐguliÃĻrement les grandes villes. Les mÃĐdias relatent quotidiennement le renouvellement de pics de pollution et le dÃĐpassement des seuils dâalerte, et les attribuent aux particules fines et aux poussiÃĻres de compositions diverses en suspension dans lâatmosphÃĻre (chauffage au bois et au fioul, industrie, moteurs surtout diesel en ville). Aussi, les mesures adoptÃĐes pour lutter contre cette pollution ne seraient-elles pas des mesures en trompe-lâÅil occultant des ÂŦ blocages Âŧ, des incohÃĐrences ou le recours à des pratiques et à des techniques de nÃĐgociations des normes ? Pollution AtmosphÃĐrique, 233. Les enjeux de la pollution de lâair en France : dÃĐlaissement ou droit en jeu(x) = The stakes of air pollution in France: absence-presence of the law-maker [texte imprimÃĐ] / H. J. Scarwell, Auteur . - 2017.
Tags : action publique droit de lâenvironnement europÃĐen pollution de lâair rÃĐgulation santÃĐ publique stratÃĐgie et rÃīle du droit RÃĐsumÃĐ : En France, des voiles de pollution recouvrent rÃĐguliÃĻrement les grandes villes. Les mÃĐdias relatent quotidiennement le renouvellement de pics de pollution et le dÃĐpassement des seuils dâalerte, et les attribuent aux particules fines et aux poussiÃĻres de compositions diverses en suspension dans lâatmosphÃĻre (chauffage au bois et au fioul, industrie, moteurs surtout diesel en ville). Aussi, les mesures adoptÃĐes pour lutter contre cette pollution ne seraient-elles pas des mesures en trompe-lâÅil occultant des ÂŦ blocages Âŧ, des incohÃĐrences ou le recours à des pratiques et à des techniques de nÃĐgociations des normes ? Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L233_ScarwellAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 233. Ozone troposphÃĐrique en France : distribution spatiale et tendances sur la pÃĐriode 1999-2012 / Sicard P.

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 233 Titre : Ozone troposphÃĐrique en France : distribution spatiale et tendances sur la pÃĐriode 1999-2012 Titre original : Tropospheric ozone in France: spatial distribution and trends over the time period 1999-2012 Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Sicard P., Auteur ; Rossello P., Auteur AnnÃĐe de publication : 2017 Tags : AOT40 ozone SOMO35 tendance test de Mann-Kendall RÃĐsumÃĐ : Les donnÃĐes horaires dâozone (O3) de 332 stations de surveillance, rÃĐparties en France, ont ÃĐtÃĐ analysÃĐes sur la pÃĐriode 1999-2012 afin de calculer les tendances à court terme. Dans le contexte actuel de changement climatique, lâÃĐlaboration dâindicateurs dâexposition pour la protection de la santÃĐ et de la vÃĐgÃĐtation permet dâÃĐtablir des normes appropriÃĐes et des politiques europÃĐennes efficaces pour rÃĐduire les effets nÃĐfastes de lâO3. La gÃĐnÃĐration de cartes dâO3 prÃĐcises, pour lâÃĐvaluation de lâexposition et des risques pour les populations et les ÃĐcosystÃĻmes, est difficile. Pour contrer ce problÃĻme, une approche dâinterpolation locale a ÃĐtÃĐ proposÃĐe pour cartographier les niveaux dâO3 à partir des donnÃĐes issues des stations de surveillance.Les statistiques annuelles dâO3 et les indicateurs dâimpact sur la santÃĐ humaine et sur la vÃĐgÃĐtation ont ÃĐtÃĐ ÃĐtudiÃĐs. La population est plus exposÃĐe à des niveaux ÃĐlevÃĐs dâO3 en zone rurale quâen ville. Les concentrations moyennes annuelles en O3 ont diminuÃĐ de 0,12 ppb.an-1 en zone rurale. La diminution significative des pics dâO3 au printemps et en ÃĐtÃĐ est associÃĐe à des rÃĐductions substantielles des ÃĐmissions de NOx et de COV dans lâUE-28 depuis le dÃĐbut des annÃĐes 1990. à lâinverse, les niveaux dâO3 sont en hausse dans les stations urbaines (+ 0,14 ppb.an-1), en particulier pendant la pÃĐriode froide.Cette augmentation peut Être attribuÃĐe à lâaugmentation des apports dâO3 (et de ses prÃĐcurseurs) par le transport transcontinental et à une plus faible destruction de lâO3 par le NO en raison de la rÃĐduction des ÃĐmissions locales de NOx. Entre 1999 et 2012, les tendances montrent que la menace pour la population et la vÃĐgÃĐtation a diminuÃĐ en France, ce qui dÃĐmontre le succÃĻs des stratÃĐgies de contrÃīle des ÃĐmissions en Europe au cours des 20 derniÃĻres annÃĐes. Cependant, pour tous les indicateurs dâexposition, les seuils de protection sont dÃĐpassÃĐs rÃĐguliÃĻrement, et les objectifs des directives europÃĐennes de qualitÃĐ de lâair ne sont pas respectÃĐs. Pour lâO3, la rÃĐgion à haut risque est le Sud-Est de la France. Cette ÃĐtude apporte des informations innovantes sur i) la distribution spatiale des concentrations en O3 ; ii) les dÃĐpassements ; iii) les tendances afin de dÃĐfinir des normes plus appropriÃĐes pour la protection de la santÃĐ humaine et des ÃĐcosystÃĻmes en France. Pollution AtmosphÃĐrique, 233. Ozone troposphÃĐrique en France : distribution spatiale et tendances sur la pÃĐriode 1999-2012 = Tropospheric ozone in France: spatial distribution and trends over the time period 1999-2012 [texte imprimÃĐ] / Sicard P., Auteur ; Rossello P., Auteur . - 2017.
Tags : AOT40 ozone SOMO35 tendance test de Mann-Kendall RÃĐsumÃĐ : Les donnÃĐes horaires dâozone (O3) de 332 stations de surveillance, rÃĐparties en France, ont ÃĐtÃĐ analysÃĐes sur la pÃĐriode 1999-2012 afin de calculer les tendances à court terme. Dans le contexte actuel de changement climatique, lâÃĐlaboration dâindicateurs dâexposition pour la protection de la santÃĐ et de la vÃĐgÃĐtation permet dâÃĐtablir des normes appropriÃĐes et des politiques europÃĐennes efficaces pour rÃĐduire les effets nÃĐfastes de lâO3. La gÃĐnÃĐration de cartes dâO3 prÃĐcises, pour lâÃĐvaluation de lâexposition et des risques pour les populations et les ÃĐcosystÃĻmes, est difficile. Pour contrer ce problÃĻme, une approche dâinterpolation locale a ÃĐtÃĐ proposÃĐe pour cartographier les niveaux dâO3 à partir des donnÃĐes issues des stations de surveillance.Les statistiques annuelles dâO3 et les indicateurs dâimpact sur la santÃĐ humaine et sur la vÃĐgÃĐtation ont ÃĐtÃĐ ÃĐtudiÃĐs. La population est plus exposÃĐe à des niveaux ÃĐlevÃĐs dâO3 en zone rurale quâen ville. Les concentrations moyennes annuelles en O3 ont diminuÃĐ de 0,12 ppb.an-1 en zone rurale. La diminution significative des pics dâO3 au printemps et en ÃĐtÃĐ est associÃĐe à des rÃĐductions substantielles des ÃĐmissions de NOx et de COV dans lâUE-28 depuis le dÃĐbut des annÃĐes 1990. à lâinverse, les niveaux dâO3 sont en hausse dans les stations urbaines (+ 0,14 ppb.an-1), en particulier pendant la pÃĐriode froide.Cette augmentation peut Être attribuÃĐe à lâaugmentation des apports dâO3 (et de ses prÃĐcurseurs) par le transport transcontinental et à une plus faible destruction de lâO3 par le NO en raison de la rÃĐduction des ÃĐmissions locales de NOx. Entre 1999 et 2012, les tendances montrent que la menace pour la population et la vÃĐgÃĐtation a diminuÃĐ en France, ce qui dÃĐmontre le succÃĻs des stratÃĐgies de contrÃīle des ÃĐmissions en Europe au cours des 20 derniÃĻres annÃĐes. Cependant, pour tous les indicateurs dâexposition, les seuils de protection sont dÃĐpassÃĐs rÃĐguliÃĻrement, et les objectifs des directives europÃĐennes de qualitÃĐ de lâair ne sont pas respectÃĐs. Pour lâO3, la rÃĐgion à haut risque est le Sud-Est de la France. Cette ÃĐtude apporte des informations innovantes sur i) la distribution spatiale des concentrations en O3 ; ii) les dÃĐpassements ; iii) les tendances afin de dÃĐfinir des normes plus appropriÃĐes pour la protection de la santÃĐ humaine et des ÃĐcosystÃĻmes en France. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L233_SicardAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 233. Pollution atmosphÃĐrique, climat et sociÃĐtÃĐ : quelle place aujourdâhui dans la ÂŦ ville durable Âŧ ? Une analyse comparÃĐe à partir de la littÃĐrature francophone et anglophone / P. Hamman

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 233 Titre : Pollution atmosphÃĐrique, climat et sociÃĐtÃĐ : quelle place aujourdâhui dans la ÂŦ ville durable Âŧ ? Une analyse comparÃĐe à partir de la littÃĐrature francophone et anglophone Titre original : Investigating the place of air pollution, climate and society in todayâs âsustainable citiesâ. A comparative review of the French and English-language literature Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : P. Hamman, Auteur AnnÃĐe de publication : 2017 Tags : air analyse statistique et lexicale climat durabilitÃĐ ÃĐnergie logement mÃĐtabolisme urbain pollution revue de littÃĐrature transports ville durable RÃĐsumÃĐ : La problÃĐmatique air-climat-sociÃĐtÃĐ est caractÃĐrisÃĐe à lâheure actuelle par une double propriÃĐtÃĐ de transversalitÃĐ (les polluants altÃĐrant la qualitÃĐ de lâair et responsables des gaz à effet de serre sont souvent les mÊmes) et de multiscalaritÃĐ (de lâÃĐchelle du bÃĒti à celle de la planÃĻte). à partir de ce point de dÃĐpart et sous lâangle des sciences sociales, lâarticle interroge la place dÃĐvolue à ces enjeux au sein du rÃĐpertoire de la ÂŦ ville durable Âŧ, qui marque de plus en plus les façons de faire et vivre la ville.
Nous dÃĐplaçons le regard à partir de ce qui est souvent lu dâabord comme des questions techniques (mesure de la pollution atmosphÃĐrique, etc.), pour les restituer dans leur ÃĐpaisseur sociale, celle de lâaction publique autant que des modes de vie en ville. MÃĐthodologiquement, nous procÃĐdons par une approche bibliomÃĐtrique comparÃĐe, à partir dâun corpus de 18 revues scientifiques, francophones et anglophones. Une analyse statistique et textuelle a ÃĐtÃĐ conduite avec le logiciel libre IRaMuTeQ, spÃĐcifiant des univers de co-occurrence lexicale. Elle ÃĐtablit la portÃĐe de trois dÃĐclinaisons structurantes dans les lectures à la fois notionnelles, critiques et plus appliquÃĐes de la durabilitÃĐ urbaine : le changement climatique et ses modÃĻles, les dÃĐplacements et transports urbains, et le mÃĐtabolisme urbain rapportÃĐ aux consommations dâÃĐnergie et aux flux de matiÃĻres. Au final, câest une double dimension thÃĐorique et pratique qui fait sens, et quâatteste la dÃĐmonstration à travers la force des liens entre les termes rÃĐcurrents, les classes lexicales et les segments significatifs dÃĐgagÃĐs.Pollution AtmosphÃĐrique, 233. Pollution atmosphÃĐrique, climat et sociÃĐtÃĐ : quelle place aujourdâhui dans la ÂŦ ville durable Âŧ ? Une analyse comparÃĐe à partir de la littÃĐrature francophone et anglophone = Investigating the place of air pollution, climate and society in todayâs âsustainable citiesâ. A comparative review of the French and English-language literature [texte imprimÃĐ] / P. Hamman, Auteur . - 2017.
Tags : air analyse statistique et lexicale climat durabilitÃĐ ÃĐnergie logement mÃĐtabolisme urbain pollution revue de littÃĐrature transports ville durable RÃĐsumÃĐ : La problÃĐmatique air-climat-sociÃĐtÃĐ est caractÃĐrisÃĐe à lâheure actuelle par une double propriÃĐtÃĐ de transversalitÃĐ (les polluants altÃĐrant la qualitÃĐ de lâair et responsables des gaz à effet de serre sont souvent les mÊmes) et de multiscalaritÃĐ (de lâÃĐchelle du bÃĒti à celle de la planÃĻte). à partir de ce point de dÃĐpart et sous lâangle des sciences sociales, lâarticle interroge la place dÃĐvolue à ces enjeux au sein du rÃĐpertoire de la ÂŦ ville durable Âŧ, qui marque de plus en plus les façons de faire et vivre la ville.
Nous dÃĐplaçons le regard à partir de ce qui est souvent lu dâabord comme des questions techniques (mesure de la pollution atmosphÃĐrique, etc.), pour les restituer dans leur ÃĐpaisseur sociale, celle de lâaction publique autant que des modes de vie en ville. MÃĐthodologiquement, nous procÃĐdons par une approche bibliomÃĐtrique comparÃĐe, à partir dâun corpus de 18 revues scientifiques, francophones et anglophones. Une analyse statistique et textuelle a ÃĐtÃĐ conduite avec le logiciel libre IRaMuTeQ, spÃĐcifiant des univers de co-occurrence lexicale. Elle ÃĐtablit la portÃĐe de trois dÃĐclinaisons structurantes dans les lectures à la fois notionnelles, critiques et plus appliquÃĐes de la durabilitÃĐ urbaine : le changement climatique et ses modÃĻles, les dÃĐplacements et transports urbains, et le mÃĐtabolisme urbain rapportÃĐ aux consommations dâÃĐnergie et aux flux de matiÃĻres. Au final, câest une double dimension thÃĐorique et pratique qui fait sens, et quâatteste la dÃĐmonstration à travers la force des liens entre les termes rÃĐcurrents, les classes lexicales et les segments significatifs dÃĐgagÃĐs.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L233_HammanAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphÃĐrique, 233. VariabilitÃĐ physico-chimique des ÃĐpisodes de pollution atmosphÃĐrique à proximitÃĐ de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer / Dron J

Titre de sÃĐrie : Pollution AtmosphÃĐrique, 233 Titre : VariabilitÃĐ physico-chimique des ÃĐpisodes de pollution atmosphÃĐrique à proximitÃĐ de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer Titre original : Physico-chemical variability of the atmospheric pollution episodes in the vicinity of the industrialo-portuary zone of Fos-sur-Mer Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Dron J, Auteur ; Chamaret P, Auteur ; Marchand N., Auteur ; Temime-Roussel B., Auteur ; Ravier S., Auteur ; Sylvestre A., Auteur ; Wortham H., Auteur AnnÃĐe de publication : 2017 Tags : composÃĐs organiques volatils composition chimique Fos-sur-Mer nombre de particules taille de particules zone industrielle RÃĐsumÃĐ : Une meilleure connaissance des ÃĐpisodes de pollution atmosphÃĐrique aux abords des zones industrialo-portuaires est indispensable à lâÃĐvaluation de leurs impacts environnementaux et sanitaires à lâÃĐchelle locale. Or on constate un manque de donnÃĐes autour des sites industriels. Des moyens importants de mesures atmosphÃĐriques ont ÃĐtÃĐ dÃĐployÃĐs à Fos-sur-Mer et à Miramas, à proximitÃĐ des complexes industriels de la zone de Fos-Ãtang de Berre, afin de produire un aperçu dÃĐtaillÃĐ des caractÃĐristiques physico-chimiques des particules et des composÃĐs organiques volatils prÃĐsents dans un environnement industriel.
Les rÃĐsultats obtenus tÃĐmoignent de la complexitÃĐ et de la variabilitÃĐ des ÃĐpisodes de pollution, tant du point de vue du nombre et de la granulomÃĐtrie des particules que de leur composition chimique. Au cours de cette campagne dâun mois (juin 2011), le nombre de particules dÃĐpasse à plusieurs reprises 100 000 particules.cm-3, souvent associÃĐs à des pics de SO2. Le nombre de particules nâest en revanche que peu corrÃĐlÃĐ aux variations de PM10. Les ÃĐlÃĐvations sont gÃĐnÃĐralement rapides et intenses pour le nombre de particules comme pour les composÃĐs organiques volatils, mais ces derniers ne sont pas systÃĐmatiquement associÃĐs aux particules ou au SO2.
Ces rÃĐsultats traduisent une exposition des populations de ce territoire à des pics intenses de pollution atmosphÃĐrique, notamment en nombre de particules ultrafines, et ce malgrÃĐ des indicateurs rÃĐglementaires ne marquant aucun dÃĐpassement au cours de la campagne. La spÃĐcificitÃĐ des zones industrielles avec de nombreuses sources fixes et variÃĐes conduit à une exposition du site de Fos-sur-Mer particuliÃĻrement complexe et changeante. DâaprÃĻs les rÃĐsultats obtenus, il semble que le site de Miramas, plus ÃĐloignÃĐ de la zone industrialo-portuaire, subisse ÃĐgalement lâinfluence des ÃĐmissions issues de lâactivitÃĐ industrielle et logistique.Pollution AtmosphÃĐrique, 233. VariabilitÃĐ physico-chimique des ÃĐpisodes de pollution atmosphÃĐrique à proximitÃĐ de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer = Physico-chemical variability of the atmospheric pollution episodes in the vicinity of the industrialo-portuary zone of Fos-sur-Mer [texte imprimÃĐ] / Dron J, Auteur ; Chamaret P, Auteur ; Marchand N., Auteur ; Temime-Roussel B., Auteur ; Ravier S., Auteur ; Sylvestre A., Auteur ; Wortham H., Auteur . - 2017.
Tags : composÃĐs organiques volatils composition chimique Fos-sur-Mer nombre de particules taille de particules zone industrielle RÃĐsumÃĐ : Une meilleure connaissance des ÃĐpisodes de pollution atmosphÃĐrique aux abords des zones industrialo-portuaires est indispensable à lâÃĐvaluation de leurs impacts environnementaux et sanitaires à lâÃĐchelle locale. Or on constate un manque de donnÃĐes autour des sites industriels. Des moyens importants de mesures atmosphÃĐriques ont ÃĐtÃĐ dÃĐployÃĐs à Fos-sur-Mer et à Miramas, à proximitÃĐ des complexes industriels de la zone de Fos-Ãtang de Berre, afin de produire un aperçu dÃĐtaillÃĐ des caractÃĐristiques physico-chimiques des particules et des composÃĐs organiques volatils prÃĐsents dans un environnement industriel.
Les rÃĐsultats obtenus tÃĐmoignent de la complexitÃĐ et de la variabilitÃĐ des ÃĐpisodes de pollution, tant du point de vue du nombre et de la granulomÃĐtrie des particules que de leur composition chimique. Au cours de cette campagne dâun mois (juin 2011), le nombre de particules dÃĐpasse à plusieurs reprises 100 000 particules.cm-3, souvent associÃĐs à des pics de SO2. Le nombre de particules nâest en revanche que peu corrÃĐlÃĐ aux variations de PM10. Les ÃĐlÃĐvations sont gÃĐnÃĐralement rapides et intenses pour le nombre de particules comme pour les composÃĐs organiques volatils, mais ces derniers ne sont pas systÃĐmatiquement associÃĐs aux particules ou au SO2.
Ces rÃĐsultats traduisent une exposition des populations de ce territoire à des pics intenses de pollution atmosphÃĐrique, notamment en nombre de particules ultrafines, et ce malgrÃĐ des indicateurs rÃĐglementaires ne marquant aucun dÃĐpassement au cours de la campagne. La spÃĐcificitÃĐ des zones industrielles avec de nombreuses sources fixes et variÃĐes conduit à une exposition du site de Fos-sur-Mer particuliÃĻrement complexe et changeante. DâaprÃĻs les rÃĐsultats obtenus, il semble que le site de Miramas, plus ÃĐloignÃĐ de la zone industrialo-portuaire, subisse ÃĐgalement lâinfluence des ÃĐmissions issues de lâactivitÃĐ industrielle et logistique.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitÃĐ aucun exemplaire Documents numÃĐriques

L233_DronAdobe Acrobat PDF