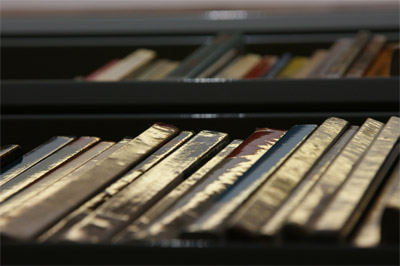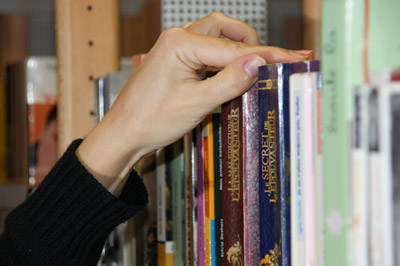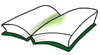Association pour la PrƩvention de la Pollution AtmosphƩrique
Revue Pollution AtmosphĆ©rique nĀ°224 (Janvier-Mars 2015)



 Affiner la recherche
Affiner la recherchePollution AtmosphƩrique, 224. Impact de l'activitƩ des ongleries sur la qualitƩ de l'air intƩrieur des logements riverains en rƩgion parisienne / Goupil G.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 224 Titre : Impact de l'activitĆ© des ongleries sur la qualitĆ© de l'air intĆ©rieur des logements riverains en rĆ©gion parisienne Titre original : Nail bars impact on housing futher in Paris region Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Goupil G., Auteur ; Faure E., Auteur ; Paillat L., Auteur ; Thiault G., Auteur ; Durupt L., Auteur ; Delaunay C., Auteur ; BesanƧon S., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : activitĆ©s urbaines activitĆ©s industrielles impact sur l'environnement santĆ© publique Pairs qualitĆ© de l'air intĆ©rieur QAI tĆ©trachlorĆ©thylĆØne nuisances olfatives mĆ©thacrylate de mĆ©thyle mĆ©thacrylate d'Ć©thyle acĆ©tate d'Ć©thyle acĆ©tate de butyle acĆ©tate mĆ©thacylate polluants autoritĆ©s publiques et sanitaires RĆ©sumĆ© : Le Laboratoire Central de la PrĆ©fecture de Police (LCPP), dans le cadre de ses missions de service public, est chargĆ© d'Ć©valuer l'impact d'activitĆ©s urbaines et industrielles sur l'environnement, sur la santĆ© publique des riverains, Ć Paris et dans les trois dĆ©partements de la petite couronne. Il met en Ć©vidence en milieu urbain de nombreuses nuisances provenant d'Ć©tablissements Ć activitĆ©s artisanales (pressing, onglerie, atelier de scooters, cabine de peinture...) Ć proximitĆ© de logements riverains Ć l'origine de la dĆ©tĆ©rioration de la qualitĆ© de l'air intĆ©rieur de ces logements. L'impact des pressings a dĆ©jĆ fait l'objet d'un bilan qui a montrĆ© des niveaux de concentrations en tĆ©trachlorĆ©thylĆØne nettement supĆ©rieurs aux valeurs de rĆ©fĆ©rence (Goupil et al., 2012).
En ce qui concerne l'activitĆ© des ongleries, les enquĆŖtes effectuĆ©es Ć la suite de plaintes pour nuisance olfactive ont permis de mettre en Ć©vidence des concentrations importantes en composĆ©s organiques volatils, en particulier le mĆ©thacrylate de mĆ©thyle, le mĆ©thacrylate d'Ć©thyle, l'acĆ©tate d'Ć©thyle et l'acĆ©tate de butyle dans l'air intĆ©rieur des logements.
Deux techniques de prĆ©lĆØvement ont Ć©tĆ© adoptĆ©es pour mesurer ces polluants, l'une par mĆ©thode passive sur 2 Ć 7 jours, et l'autre par mĆ©thode active sur un support adsorbant contenant du charbon actif sur des durĆ©es allant de 1 Ć 7 heures. AprĆØs dĆ©sorption solvant, l'identification et le dosage des composĆ©s ont Ć©tĆ© effectuĆ©s par chromatographie en phase gazeuse couplĆ©e Ć un dĆ©tecteur Ć ionisation de flamme (GC/FID) et Ć un spectromĆØtre de masse (GC/MS). Le LCPP est accrĆ©ditĆ© par le Cofrac pour la mesure de certains COV dans l'air. L'incertitude des mesures est estimĆ©e Ć environ 20 %. Il a Ć©tĆ© mesurĆ© notamment une concentration de 4 600 Āµg/m3 en mĆ©thacrylate de mĆ©thyle dans l'entrĆ©e d'un appartement situĆ© Ć proximitĆ© d'une onglerie ; cette valeur reprĆ©sente 90 fois la valeur toxicologique de rĆ©fĆ©rence recommandĆ©e par le Canada (52 Āµg/m3). L'absence de valeur de rĆ©fĆ©rence en France pour ces produits chimiques dans l'air intĆ©rieur rend difficile l'obligation de travaux pour les exploitants d'onglerie. L'objectif est donc d'alerter les autoritĆ©s publiques et sanitaires en prĆ©sentant les rĆ©sultats des concentrations obtenues lors de la rĆ©alisation d'enquĆŖtes, et de prĆ©senter des exemples de cas rencontrĆ©s en dĆ©terminant les diffĆ©rentes voies de transfert (ventilation, plafond...).Pollution AtmosphĆ©rique, 224. Impact de l'activitĆ© des ongleries sur la qualitĆ© de l'air intĆ©rieur des logements riverains en rĆ©gion parisienne = Nail bars impact on housing futher in Paris region [texte imprimĆ©] / Goupil G., Auteur ; Faure E., Auteur ; Paillat L., Auteur ; Thiault G., Auteur ; Durupt L., Auteur ; Delaunay C., Auteur ; BesanƧon S., Auteur . - 2015.
Tags : activitĆ©s urbaines activitĆ©s industrielles impact sur l'environnement santĆ© publique Pairs qualitĆ© de l'air intĆ©rieur QAI tĆ©trachlorĆ©thylĆØne nuisances olfatives mĆ©thacrylate de mĆ©thyle mĆ©thacrylate d'Ć©thyle acĆ©tate d'Ć©thyle acĆ©tate de butyle acĆ©tate mĆ©thacylate polluants autoritĆ©s publiques et sanitaires RĆ©sumĆ© : Le Laboratoire Central de la PrĆ©fecture de Police (LCPP), dans le cadre de ses missions de service public, est chargĆ© d'Ć©valuer l'impact d'activitĆ©s urbaines et industrielles sur l'environnement, sur la santĆ© publique des riverains, Ć Paris et dans les trois dĆ©partements de la petite couronne. Il met en Ć©vidence en milieu urbain de nombreuses nuisances provenant d'Ć©tablissements Ć activitĆ©s artisanales (pressing, onglerie, atelier de scooters, cabine de peinture...) Ć proximitĆ© de logements riverains Ć l'origine de la dĆ©tĆ©rioration de la qualitĆ© de l'air intĆ©rieur de ces logements. L'impact des pressings a dĆ©jĆ fait l'objet d'un bilan qui a montrĆ© des niveaux de concentrations en tĆ©trachlorĆ©thylĆØne nettement supĆ©rieurs aux valeurs de rĆ©fĆ©rence (Goupil et al., 2012).
En ce qui concerne l'activitĆ© des ongleries, les enquĆŖtes effectuĆ©es Ć la suite de plaintes pour nuisance olfactive ont permis de mettre en Ć©vidence des concentrations importantes en composĆ©s organiques volatils, en particulier le mĆ©thacrylate de mĆ©thyle, le mĆ©thacrylate d'Ć©thyle, l'acĆ©tate d'Ć©thyle et l'acĆ©tate de butyle dans l'air intĆ©rieur des logements.
Deux techniques de prĆ©lĆØvement ont Ć©tĆ© adoptĆ©es pour mesurer ces polluants, l'une par mĆ©thode passive sur 2 Ć 7 jours, et l'autre par mĆ©thode active sur un support adsorbant contenant du charbon actif sur des durĆ©es allant de 1 Ć 7 heures. AprĆØs dĆ©sorption solvant, l'identification et le dosage des composĆ©s ont Ć©tĆ© effectuĆ©s par chromatographie en phase gazeuse couplĆ©e Ć un dĆ©tecteur Ć ionisation de flamme (GC/FID) et Ć un spectromĆØtre de masse (GC/MS). Le LCPP est accrĆ©ditĆ© par le Cofrac pour la mesure de certains COV dans l'air. L'incertitude des mesures est estimĆ©e Ć environ 20 %. Il a Ć©tĆ© mesurĆ© notamment une concentration de 4 600 Āµg/m3 en mĆ©thacrylate de mĆ©thyle dans l'entrĆ©e d'un appartement situĆ© Ć proximitĆ© d'une onglerie ; cette valeur reprĆ©sente 90 fois la valeur toxicologique de rĆ©fĆ©rence recommandĆ©e par le Canada (52 Āµg/m3). L'absence de valeur de rĆ©fĆ©rence en France pour ces produits chimiques dans l'air intĆ©rieur rend difficile l'obligation de travaux pour les exploitants d'onglerie. L'objectif est donc d'alerter les autoritĆ©s publiques et sanitaires en prĆ©sentant les rĆ©sultats des concentrations obtenues lors de la rĆ©alisation d'enquĆŖtes, et de prĆ©senter des exemples de cas rencontrĆ©s en dĆ©terminant les diffĆ©rentes voies de transfert (ventilation, plafond...).Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L224_GoupilAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphƩrique, 224. Impact des stratƩgies de post-traitement et des biocarburants sur la mutagƩnicitƩ des Ʃmissions de moteurs diesel / V. AndrƩ

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 224 Titre : Impact des stratĆ©gies de post-traitement et des biocarburants sur la mutagĆ©nicitĆ© des Ć©missions de moteurs diesel Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : V. AndrĆ©, Auteur ; Barraud C., Auteur ; Preterre D., Auteur ; Cazier F., Auteur ; Morin JP., Auteur ; Sichel F., Auteur AnnĆ©e de publication : 2014 Tags : mutagĆ©nicitĆ© France automobile produits de combustion gazole gazole standard gazole additivĆ© ester mĆ©thylique de colza phase particulaire phase de l'aĆ©rosol complet aĆ©rosol aldĆ©hydes NOx nitro-HAP systĆØmes de post-traitement dispositifs de dĆ©pollution Ć©missions polluantes biocarburants systĆØmes de dĆ©pollution RĆ©sumĆ© : Ce travail a pour objectif principal dā€™Ć©valuer, au moyen du test dā€™Ames, la mutagĆ©nicitĆ© de la phase particulaire et de lā€™aĆ©rosol complet gĆ©nĆ©rĆ©s par le fonctionnement dā€™un moteur turbo-diesel reprĆ©sentatif du parc automobile franƧais en circulation en 2011 (norme Euro 3). La mutagĆ©nicitĆ© des produits de combustion obtenus a Ć©tĆ© comparĆ©e pour trois types de gazoles : un gazole standard (GO) et deux gazoles additivĆ©s Ć 7 % (G7) et 30 % (G30) dā€™esters mĆ©thyliques de colza. Les rĆ©sultats de lā€™Ć©tude montrent que si la mutagĆ©nicitĆ© de la phase particulaire est principalement associĆ©e aux nitro-aromatiques adsorbĆ©s, celle de lā€™aĆ©rosol complet impliquerait essentiellement des composĆ©s de la phase gazeuse tels que des aldĆ©hydes et les NOx. Lā€™impact de systĆØmes de post-traitement (catalyseur dā€™oxydation et filtre Ć particule) sur la mutagĆ©nicitĆ© des effluents Ć©mis est Ć©galement examinĆ©. Il est montrĆ© que ces dispositifs de dĆ©pollution sā€™avĆØrent efficaces (particuliĆØrement le catalyseur dā€™oxydation) pour rĆ©duire, voire abolir, la mutagĆ©nicitĆ© des Ć©missions de moteurs diesel. Ce travail met en Ć©vidence tout lā€™intĆ©rĆŖt quā€™il y a dā€™opĆ©rer avec lā€™aĆ©rosol complet pour les expositions rĆ©alisĆ©es dans le cadre des tests dā€™Ames. Pollution AtmosphĆ©rique, 224. Impact des stratĆ©gies de post-traitement et des biocarburants sur la mutagĆ©nicitĆ© des Ć©missions de moteurs diesel [texte imprimĆ©] / V. AndrĆ©, Auteur ; Barraud C., Auteur ; Preterre D., Auteur ; Cazier F., Auteur ; Morin JP., Auteur ; Sichel F., Auteur . - 2014.
Tags : mutagĆ©nicitĆ© France automobile produits de combustion gazole gazole standard gazole additivĆ© ester mĆ©thylique de colza phase particulaire phase de l'aĆ©rosol complet aĆ©rosol aldĆ©hydes NOx nitro-HAP systĆØmes de post-traitement dispositifs de dĆ©pollution Ć©missions polluantes biocarburants systĆØmes de dĆ©pollution RĆ©sumĆ© : Ce travail a pour objectif principal dā€™Ć©valuer, au moyen du test dā€™Ames, la mutagĆ©nicitĆ© de la phase particulaire et de lā€™aĆ©rosol complet gĆ©nĆ©rĆ©s par le fonctionnement dā€™un moteur turbo-diesel reprĆ©sentatif du parc automobile franƧais en circulation en 2011 (norme Euro 3). La mutagĆ©nicitĆ© des produits de combustion obtenus a Ć©tĆ© comparĆ©e pour trois types de gazoles : un gazole standard (GO) et deux gazoles additivĆ©s Ć 7 % (G7) et 30 % (G30) dā€™esters mĆ©thyliques de colza. Les rĆ©sultats de lā€™Ć©tude montrent que si la mutagĆ©nicitĆ© de la phase particulaire est principalement associĆ©e aux nitro-aromatiques adsorbĆ©s, celle de lā€™aĆ©rosol complet impliquerait essentiellement des composĆ©s de la phase gazeuse tels que des aldĆ©hydes et les NOx. Lā€™impact de systĆØmes de post-traitement (catalyseur dā€™oxydation et filtre Ć particule) sur la mutagĆ©nicitĆ© des effluents Ć©mis est Ć©galement examinĆ©. Il est montrĆ© que ces dispositifs de dĆ©pollution sā€™avĆØrent efficaces (particuliĆØrement le catalyseur dā€™oxydation) pour rĆ©duire, voire abolir, la mutagĆ©nicitĆ© des Ć©missions de moteurs diesel. Ce travail met en Ć©vidence tout lā€™intĆ©rĆŖt quā€™il y a dā€™opĆ©rer avec lā€™aĆ©rosol complet pour les expositions rĆ©alisĆ©es dans le cadre des tests dā€™Ames. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L224_AndréURLPollution AtmosphĆ©rique, 224. RĆ©partition et quantification des sources de HAP en vallĆ©es alpines par des composĆ©s organiques soufrĆ©s : impact industriel ? / Golly B.
Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 224 Titre : RĆ©partition et quantification des sources de HAP en vallĆ©es alpines par des composĆ©s organiques soufrĆ©s : impact industriel ? Titre original : Source apportionment of PAHs in two Alpine valleys using Sulfur-containing Organic Compounds: industrial impact? Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Golly B., Auteur ; Piot C., Auteur ; J. L. Jaffrezo, Auteur ; Brulfert G., Auteur ; Berlioux G., Auteur ; Besombes JL, Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : RĆ©gion RhĆ´ne-Alpes Ć©missions industrielles vallĆ©es alpines vallĆ©e de l'Arve vallĆ©e de la Tarentaise sources Ć©mettrices de HAP chauffage au bois trafic routier industrie modĆØles rĆ©cepteurs de dĆ©convolution sources d'Ć©missions de PM polluants atmosphĆ©riques profil chimique combustion du bois composĆ©s aromatiques soufrĆ©s Ć©missions vĆ©hiculaires soufre RĆ©sumĆ© : La rĆ©gion RhĆ´ne-Alpes, et plus particuliĆØrement les vallĆ©es alpines de lā€™Arve et de la Tarentaise, constitue lā€™une des zones gĆ©ographiques en France particuliĆØrement concernĆ©es par les dĆ©passements de valeurs autorisĆ©es en PM10. Au cours des annĆ©es 2007-2010, les nombres de jours de dĆ©passement sur le site de mesure de la vallĆ©e de lā€™Arve Ć Passy (Air Rhone-Alpes) sont frĆ©quemment au-dessus de la limite rĆ©glementaire autorisĆ©e fixĆ©e Ć 37 jours par an.
Selon les cadastres des Ć©missions de HAP, ces sites sont fortement impactĆ©s par 3 principaux secteurs dā€™activitĆ©s : le chauffage au bois, le trafic routier et lā€™industrie. Ces derniĆØres annĆ©es, des travaux menĆ©s au LCME et au LGGE sur lā€™utilisation de modĆØles rĆ©cepteurs de dĆ©convolution des sources dā€™Ć©mission de PM basĆ©s notamment sur des profils chimiques (Chemical Mass Balance) ont mis en Ć©vidence la particularitĆ© des sites de montagne vis-Ć -vis de la dynamique des sources dā€™Ć©missions de polluants atmosphĆ©riques (Piot, 2011). Ces modĆØles sont basĆ©s sur lā€™utilisation de traceurs spĆ©cifiques et la comparaison de profils chimiques dā€™Ć©mission. Cependant, les approches qualitatives (Ć©tudes ratio-ratio de composĆ©s de la famille des HAP) mises en place lors de ces Ć©tudes ont montrĆ© un profil chimique similaire entre les Ć©missions de la combustion du bois et les Ć©missions issues dā€™un certain type dā€™activitĆ© industrielle. La forte similitude entre ces sources peut donc introduire un biais dans les rĆ©sultats de ces modĆØles, dā€™oĆ¹ la nĆ©cessitĆ© dā€™identifier de nouveaux traceurs spĆ©cifiques de sources dā€™Ć©missions. De janvier Ć mars 2013, deux campagnes de mesure simultanĆ©es ont Ć©tĆ© rĆ©alisĆ©es dans la vallĆ©e de lā€™Arve et de la Tarentaise. La spĆ©ciation organique rĆ©alisĆ©e sur ces Ć©chantillons journaliers a mis en Ć©vidence la prĆ©sence de composĆ©s aromatiques soufrĆ©s (PASHs) dans lā€™atmosphĆØre de ces vallĆ©es. Dans la littĆ©rature, ces composĆ©s sont couramment utilisĆ©s comme traceurs des Ć©missions vĆ©hiculaires directes. Cependant, lā€™exploration dā€™Ć©chantillons collectĆ©s en bordure de voie rapide ne rapporte pas la prĆ©sence de ces composĆ©s dans les Ć©missions vĆ©hiculaires en accord avec lā€™Ć©volution des normes europĆ©ennes sur les taux de soufre dans les essences (EU Directive 2003/17/EC). Leur dĆ©tection dans lā€™atmosphĆØre des vallĆ©es alpines possĆ©dant un important bassin industriel axĆ© sur la transformation du carbone montrerait leur aptitude Ć tracer ce type dā€™activitĆ© industrielle.
Leur introduction comme molĆ©cules traceurs Ć lā€™intĆ©rieur dā€™un modĆØle rĆ©cepteur comme le CMB et la confrontation avec un modĆØle original de rĆ©gression non linĆ©aire multivariĆ©e (NLRM) pour dĆ©convoluer les sources de HAP et de PM sont discutĆ©es afin de valider leur origine et dā€™amĆ©liorer la connaissance des diffĆ©rentes sources Ć©mettrices de HAP et de PM dans ces sites de fond de vallĆ©e.Pollution AtmosphĆ©rique, 224. RĆ©partition et quantification des sources de HAP en vallĆ©es alpines par des composĆ©s organiques soufrĆ©s : impact industriel ? = Source apportionment of PAHs in two Alpine valleys using Sulfur-containing Organic Compounds: industrial impact? [texte imprimĆ©] / Golly B., Auteur ; Piot C., Auteur ; J. L. Jaffrezo, Auteur ; Brulfert G., Auteur ; Berlioux G., Auteur ; Besombes JL, Auteur . - 2015.
Tags : RĆ©gion RhĆ´ne-Alpes Ć©missions industrielles vallĆ©es alpines vallĆ©e de l'Arve vallĆ©e de la Tarentaise sources Ć©mettrices de HAP chauffage au bois trafic routier industrie modĆØles rĆ©cepteurs de dĆ©convolution sources d'Ć©missions de PM polluants atmosphĆ©riques profil chimique combustion du bois composĆ©s aromatiques soufrĆ©s Ć©missions vĆ©hiculaires soufre RĆ©sumĆ© : La rĆ©gion RhĆ´ne-Alpes, et plus particuliĆØrement les vallĆ©es alpines de lā€™Arve et de la Tarentaise, constitue lā€™une des zones gĆ©ographiques en France particuliĆØrement concernĆ©es par les dĆ©passements de valeurs autorisĆ©es en PM10. Au cours des annĆ©es 2007-2010, les nombres de jours de dĆ©passement sur le site de mesure de la vallĆ©e de lā€™Arve Ć Passy (Air Rhone-Alpes) sont frĆ©quemment au-dessus de la limite rĆ©glementaire autorisĆ©e fixĆ©e Ć 37 jours par an.
Selon les cadastres des Ć©missions de HAP, ces sites sont fortement impactĆ©s par 3 principaux secteurs dā€™activitĆ©s : le chauffage au bois, le trafic routier et lā€™industrie. Ces derniĆØres annĆ©es, des travaux menĆ©s au LCME et au LGGE sur lā€™utilisation de modĆØles rĆ©cepteurs de dĆ©convolution des sources dā€™Ć©mission de PM basĆ©s notamment sur des profils chimiques (Chemical Mass Balance) ont mis en Ć©vidence la particularitĆ© des sites de montagne vis-Ć -vis de la dynamique des sources dā€™Ć©missions de polluants atmosphĆ©riques (Piot, 2011). Ces modĆØles sont basĆ©s sur lā€™utilisation de traceurs spĆ©cifiques et la comparaison de profils chimiques dā€™Ć©mission. Cependant, les approches qualitatives (Ć©tudes ratio-ratio de composĆ©s de la famille des HAP) mises en place lors de ces Ć©tudes ont montrĆ© un profil chimique similaire entre les Ć©missions de la combustion du bois et les Ć©missions issues dā€™un certain type dā€™activitĆ© industrielle. La forte similitude entre ces sources peut donc introduire un biais dans les rĆ©sultats de ces modĆØles, dā€™oĆ¹ la nĆ©cessitĆ© dā€™identifier de nouveaux traceurs spĆ©cifiques de sources dā€™Ć©missions. De janvier Ć mars 2013, deux campagnes de mesure simultanĆ©es ont Ć©tĆ© rĆ©alisĆ©es dans la vallĆ©e de lā€™Arve et de la Tarentaise. La spĆ©ciation organique rĆ©alisĆ©e sur ces Ć©chantillons journaliers a mis en Ć©vidence la prĆ©sence de composĆ©s aromatiques soufrĆ©s (PASHs) dans lā€™atmosphĆØre de ces vallĆ©es. Dans la littĆ©rature, ces composĆ©s sont couramment utilisĆ©s comme traceurs des Ć©missions vĆ©hiculaires directes. Cependant, lā€™exploration dā€™Ć©chantillons collectĆ©s en bordure de voie rapide ne rapporte pas la prĆ©sence de ces composĆ©s dans les Ć©missions vĆ©hiculaires en accord avec lā€™Ć©volution des normes europĆ©ennes sur les taux de soufre dans les essences (EU Directive 2003/17/EC). Leur dĆ©tection dans lā€™atmosphĆØre des vallĆ©es alpines possĆ©dant un important bassin industriel axĆ© sur la transformation du carbone montrerait leur aptitude Ć tracer ce type dā€™activitĆ© industrielle.
Leur introduction comme molĆ©cules traceurs Ć lā€™intĆ©rieur dā€™un modĆØle rĆ©cepteur comme le CMB et la confrontation avec un modĆØle original de rĆ©gression non linĆ©aire multivariĆ©e (NLRM) pour dĆ©convoluer les sources de HAP et de PM sont discutĆ©es afin de valider leur origine et dā€™amĆ©liorer la connaissance des diffĆ©rentes sources Ć©mettrices de HAP et de PM dans ces sites de fond de vallĆ©e.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĆ© aucun exemplaire Pollution AtmosphĆ©rique, 224. SynthĆØse des connaissances sur le transfert des pesticides vers lā€™atmosphĆØre par volatilisation depuis les plantes / Lichiheb N.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 224 Titre : SynthĆØse des connaissances sur le transfert des pesticides vers lā€™atmosphĆØre par volatilisation depuis les plantes Titre original : State of knowledge on the transfer of pesticides into the atmosphere by volatilization from plants Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Lichiheb N., Auteur ; Bedos C., Auteur ; Personne E., Auteur ; Barriuso E., Auteur AnnĆ©e de publication : 2015 Tags : pĆ©nĆ©tration foliaire pesticides photodĆ©gradation pollution atmosphĆ©rique volatilisation activitĆ© agricole RĆ©sumĆ© : Les niveaux de concentration des pesticides dans lā€™atmosphĆØre mĆ©ritent une attention particuliĆØre de la part de la recherche compte tenu de leurs impacts potentiels sur la population et les Ć©cosystĆØmes. Lā€™activitĆ© agricole constitue la principale source de contamination de lā€™atmosphĆØre par les pesticides. Bien que la volatilisation depuis la plante soit reconnue plus intense et plus rapide que la volatilisation depuis le sol, cette voie de transfert est Ć ce jour la moins bien renseignĆ©e avec peu de modĆØles disponibles pour sa description. Le manque de connaissances est liĆ© essentiellement Ć la complexitĆ© des interactions entre les processus ayant lieu Ć la surface de la feuille et qui sont en compĆ©tition avec la volatilisation, notamment la pĆ©nĆ©tration foliaire et la photodĆ©gradation. Cet article prĆ©sente une synthĆØse bibliographique sur lā€™Ć©tat des lieux des connaissances sur le processus de volatilisation des pesticides depuis un couvert vĆ©gĆ©tal, de la pĆ©nĆ©tration foliaire et de la photodĆ©gradation, ainsi que les facteurs de contrĆ´le de ces processus. Les mĆ©thodes de mesure ainsi que les modĆØles existants dĆ©crivant ces processus sont Ć©galement prĆ©sentĆ©s et analysĆ©s. Pollution AtmosphĆ©rique, 224. SynthĆØse des connaissances sur le transfert des pesticides vers lā€™atmosphĆØre par volatilisation depuis les plantes = State of knowledge on the transfer of pesticides into the atmosphere by volatilization from plants [texte imprimĆ©] / Lichiheb N., Auteur ; Bedos C., Auteur ; Personne E., Auteur ; Barriuso E., Auteur . - 2015.
Tags : pĆ©nĆ©tration foliaire pesticides photodĆ©gradation pollution atmosphĆ©rique volatilisation activitĆ© agricole RĆ©sumĆ© : Les niveaux de concentration des pesticides dans lā€™atmosphĆØre mĆ©ritent une attention particuliĆØre de la part de la recherche compte tenu de leurs impacts potentiels sur la population et les Ć©cosystĆØmes. Lā€™activitĆ© agricole constitue la principale source de contamination de lā€™atmosphĆØre par les pesticides. Bien que la volatilisation depuis la plante soit reconnue plus intense et plus rapide que la volatilisation depuis le sol, cette voie de transfert est Ć ce jour la moins bien renseignĆ©e avec peu de modĆØles disponibles pour sa description. Le manque de connaissances est liĆ© essentiellement Ć la complexitĆ© des interactions entre les processus ayant lieu Ć la surface de la feuille et qui sont en compĆ©tition avec la volatilisation, notamment la pĆ©nĆ©tration foliaire et la photodĆ©gradation. Cet article prĆ©sente une synthĆØse bibliographique sur lā€™Ć©tat des lieux des connaissances sur le processus de volatilisation des pesticides depuis un couvert vĆ©gĆ©tal, de la pĆ©nĆ©tration foliaire et de la photodĆ©gradation, ainsi que les facteurs de contrĆ´le de ces processus. Les mĆ©thodes de mesure ainsi que les modĆØles existants dĆ©crivant ces processus sont Ć©galement prĆ©sentĆ©s et analysĆ©s. Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L224_LichihebAdobe Acrobat PDF