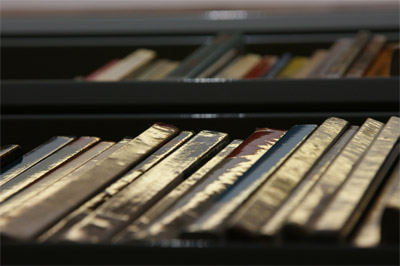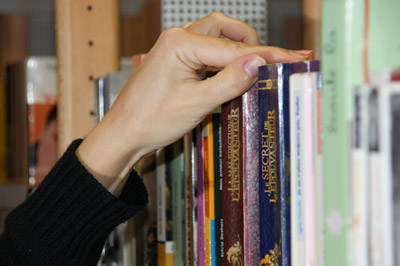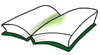Association pour la PrƩvention de la Pollution AtmosphƩrique
DƩtail de la sƩrie
Pollution AtmosphƩrique |
Documents disponibles dans cette série (136)

 Affiner la recherche
Affiner la recherchePollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Lā€™Ć©volution des systĆØmes agroforestiers en France. Leur rĆ´le en agroĆ©cologie / Dubois JJ.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230 Titre : Lā€™Ć©volution des systĆØmes agroforestiers en France. Leur rĆ´le en agroĆ©cologie Titre original : Agroforestry in France: its evolution and its role in ecological agriculture Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Dubois JJ., Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : agroĆ©cologie agroforesterie arbres hors forĆŖt bois Ć©nergie changement climatique RĆ©sumĆ© : Lā€™agroforesterie est un Ć©lĆ©ment important du projet agroĆ©cologique national lancĆ© depuis 2012. En mĆ©tropole, les systĆØmes agroforestiers traditionnels en perte de vitesse doivent impĆ©rativement rĆ©introduire une remise en valeur, Ć©conomique autant quā€™Ć©cologique, des arbres hors forĆŖt. Cā€™est le but des systĆØmes modernes intraparcellaires Ć faible densitĆ© dā€™arbres, qui affirment en outre un potentiel dā€™adaptation au changement climatique par les micro-climats quā€™ils crĆ©ent. Cā€™est le cas, par exemple, de lā€™agroforesterie viticole, encore expĆ©rimentale. La contribution de lā€™agroforesterie Ć la sĆ©questration durable du carbone, souvent mise en avant, est davantage discutĆ©e. Les services Ć©cologiques liĆ©s Ć la biodiversitĆ© et Ć la gestion de lā€™eau sont en revanche essentiels. Toutefois, ces objectifs dĆ©pendent principalement de la valorisation Ć©conomique, le dĆ©veloppement de filiĆØres locales de bois Ć©nergie concernant plutĆ´t les haies bocagĆØres et la production de bois dā€™Å“uvre dā€™essences nobles constitueraient un atout pour lā€™agroforesterie moderne. Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Lā€™Ć©volution des systĆØmes agroforestiers en France. Leur rĆ´le en agroĆ©cologie = Agroforestry in France: its evolution and its role in ecological agriculture [texte imprimĆ©] / Dubois JJ., Auteur . - 2016.
Tags : agroĆ©cologie agroforesterie arbres hors forĆŖt bois Ć©nergie changement climatique RĆ©sumĆ© : Lā€™agroforesterie est un Ć©lĆ©ment important du projet agroĆ©cologique national lancĆ© depuis 2012. En mĆ©tropole, les systĆØmes agroforestiers traditionnels en perte de vitesse doivent impĆ©rativement rĆ©introduire une remise en valeur, Ć©conomique autant quā€™Ć©cologique, des arbres hors forĆŖt. Cā€™est le but des systĆØmes modernes intraparcellaires Ć faible densitĆ© dā€™arbres, qui affirment en outre un potentiel dā€™adaptation au changement climatique par les micro-climats quā€™ils crĆ©ent. Cā€™est le cas, par exemple, de lā€™agroforesterie viticole, encore expĆ©rimentale. La contribution de lā€™agroforesterie Ć la sĆ©questration durable du carbone, souvent mise en avant, est davantage discutĆ©e. Les services Ć©cologiques liĆ©s Ć la biodiversitĆ© et Ć la gestion de lā€™eau sont en revanche essentiels. Toutefois, ces objectifs dĆ©pendent principalement de la valorisation Ć©conomique, le dĆ©veloppement de filiĆØres locales de bois Ć©nergie concernant plutĆ´t les haies bocagĆØres et la production de bois dā€™Å“uvre dā€™essences nobles constitueraient un atout pour lā€™agroforesterie moderne. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L230_DuboisAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Les habitants de lā€™espace rural : quelle exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique ? / I. Roussel

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230 Titre : Les habitants de lā€™espace rural : quelle exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique ? Titre original : The inhabitants of the rural areas: what exposure in the atmospheric pollution? Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : I. Roussel, Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : Ć©missions agricoles espace rural Ć©talement urbain exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique RĆ©sumĆ© : Quelles sont les rĆ©alitĆ©s qui se cachent derriĆØre le chiffre de 8 000 dĆ©cĆØs par an dans la France rurale, annoncĆ© par lā€™institut santĆ© publique France ? Ć€ quelle exposition est soumise cette population rurale devant faire face Ć des Ć©missions polluantes diffuses, nombreuses et variĆ©es ? La dĆ©finition mĆŖme de lā€™exposition est plus complexe que celle qui serait rĆ©duite Ć une simple information chiffrĆ©e sur la pollution ambiante issue dā€™un modĆØle. En effet, le monde rural est complexe et varie Ć©normĆ©ment en fonction des caractĆ©ristiques topoclimatiques, il est souvent prĆ©sentĆ© comme le nĆ©gatif de la ville et polluĆ© par des Ć©missions agricoles mais pas uniquement ; en particulier, lā€™espace pĆ©riurbain, plus densĆ©ment peuplĆ© par des populations plus vulnĆ©rables, est souvent le siĆØge des externalitĆ©s nĆ©gatives de la ville voisine. Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Les habitants de lā€™espace rural : quelle exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique ? = The inhabitants of the rural areas: what exposure in the atmospheric pollution? [texte imprimĆ©] / I. Roussel, Auteur . - 2016.
Tags : Ć©missions agricoles espace rural Ć©talement urbain exposition Ć la pollution atmosphĆ©rique RĆ©sumĆ© : Quelles sont les rĆ©alitĆ©s qui se cachent derriĆØre le chiffre de 8 000 dĆ©cĆØs par an dans la France rurale, annoncĆ© par lā€™institut santĆ© publique France ? Ć€ quelle exposition est soumise cette population rurale devant faire face Ć des Ć©missions polluantes diffuses, nombreuses et variĆ©es ? La dĆ©finition mĆŖme de lā€™exposition est plus complexe que celle qui serait rĆ©duite Ć une simple information chiffrĆ©e sur la pollution ambiante issue dā€™un modĆØle. En effet, le monde rural est complexe et varie Ć©normĆ©ment en fonction des caractĆ©ristiques topoclimatiques, il est souvent prĆ©sentĆ© comme le nĆ©gatif de la ville et polluĆ© par des Ć©missions agricoles mais pas uniquement ; en particulier, lā€™espace pĆ©riurbain, plus densĆ©ment peuplĆ© par des populations plus vulnĆ©rables, est souvent le siĆØge des externalitĆ©s nĆ©gatives de la ville voisine. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L230_RousselAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Impacts de lā€™ozone sur lā€™agriculture et les forĆŖts et estimation des coĆ»ts Ć©conomiques / Castell JF.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230 Titre : Impacts de lā€™ozone sur lā€™agriculture et les forĆŖts et estimation des coĆ»ts Ć©conomiques Titre original : Ozone impacts on agriculture and forests and economic losses assessment Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Castell JF., Auteur ; Le Thiec D., Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : agriculture AOT40 fonctions dose-rĆ©ponse forĆŖt impacts Ć©conomiques ozone POD pollution atmosphĆ©rique RĆ©sumĆ© : Lā€™ozone est aujourdā€™hui considĆ©rĆ© comme le polluant atmosphĆ©rique le plus nocif pour la production des cultures et des forĆŖts, et sa concentration dans lā€™air devrait encore augmenter dans les prochaines annĆ©es. Lā€™utilisation dā€™outils basĆ©s sur des relations empiriques entre les concentrations et les rendements permet dā€™estimer que la production des cultures sensibles comme le blĆ© ou les tomates peut ĆŖtre rĆ©duite de plus de 10 % dans les rĆ©gions les plus polluĆ©es, ce qui reprĆ©sente des pertes sensibles pour lā€™Ć©conomie du secteur agricole. La synthĆØse des travaux publiĆ©s sur cette question montre quā€™il existe peu dā€™Ć©tudes permettant dā€™estimer les impacts Ć©conomiques de lā€™ozone sur les forĆŖts. Pour les cultures, au niveau mondial, les pertes dues Ć lā€™ozone dĆ©passent la dizaine de milliards de dollars par an, les rĆ©gions les plus affectĆ©es Ć©tant lā€™Asie et les pays mĆ©diterranĆ©ens. En Europe, le coĆ»t de lā€™ozone sur la production du blĆ© est estimĆ© Ć 3,2 milliards dā€™euros. Pour la France, qui est un des pays dā€™Europe oĆ¹ les rendements sont les plus affectĆ©s par lā€™ozone, nous estimons que ce sont plus dā€™un milliard dā€™euros qui sont perdus chaque annĆ©e Ć cause de ce polluant. Ces estimations doivent cependant ĆŖtre considĆ©rĆ©es avec prudence, dā€™une part, parce que les mĆ©thodes actuellement disponibles sont peu prĆ©cises, dā€™autre part, parce que leur validitĆ© est incertaine pour estimer les impacts de lā€™ozone dans des rĆ©gions oĆ¹ les climats et les agricultures sont trop diffĆ©rents de lā€™AmĆ©rique du Nord ou de lā€™Europe. Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Impacts de lā€™ozone sur lā€™agriculture et les forĆŖts et estimation des coĆ»ts Ć©conomiques = Ozone impacts on agriculture and forests and economic losses assessment [texte imprimĆ©] / Castell JF., Auteur ; Le Thiec D., Auteur . - 2016.
Tags : agriculture AOT40 fonctions dose-rĆ©ponse forĆŖt impacts Ć©conomiques ozone POD pollution atmosphĆ©rique RĆ©sumĆ© : Lā€™ozone est aujourdā€™hui considĆ©rĆ© comme le polluant atmosphĆ©rique le plus nocif pour la production des cultures et des forĆŖts, et sa concentration dans lā€™air devrait encore augmenter dans les prochaines annĆ©es. Lā€™utilisation dā€™outils basĆ©s sur des relations empiriques entre les concentrations et les rendements permet dā€™estimer que la production des cultures sensibles comme le blĆ© ou les tomates peut ĆŖtre rĆ©duite de plus de 10 % dans les rĆ©gions les plus polluĆ©es, ce qui reprĆ©sente des pertes sensibles pour lā€™Ć©conomie du secteur agricole. La synthĆØse des travaux publiĆ©s sur cette question montre quā€™il existe peu dā€™Ć©tudes permettant dā€™estimer les impacts Ć©conomiques de lā€™ozone sur les forĆŖts. Pour les cultures, au niveau mondial, les pertes dues Ć lā€™ozone dĆ©passent la dizaine de milliards de dollars par an, les rĆ©gions les plus affectĆ©es Ć©tant lā€™Asie et les pays mĆ©diterranĆ©ens. En Europe, le coĆ»t de lā€™ozone sur la production du blĆ© est estimĆ© Ć 3,2 milliards dā€™euros. Pour la France, qui est un des pays dā€™Europe oĆ¹ les rendements sont les plus affectĆ©s par lā€™ozone, nous estimons que ce sont plus dā€™un milliard dā€™euros qui sont perdus chaque annĆ©e Ć cause de ce polluant. Ces estimations doivent cependant ĆŖtre considĆ©rĆ©es avec prudence, dā€™une part, parce que les mĆ©thodes actuellement disponibles sont peu prĆ©cises, dā€™autre part, parce que leur validitĆ© est incertaine pour estimer les impacts de lā€™ozone dans des rĆ©gions oĆ¹ les climats et les agricultures sont trop diffĆ©rents de lā€™AmĆ©rique du Nord ou de lā€™Europe. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L230_CastellAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Les lĆ©gumineuses, alliĆ©es dā€™une agriculture Ć©cologiquement intensive. Lā€™exemple de la luzerne / Le Chatelier D.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230 Titre : Les lĆ©gumineuses, alliĆ©es dā€™une agriculture Ć©cologiquement intensive. Lā€™exemple de la luzerne Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Le Chatelier D., Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : lĆ©gumineuse azote engrais pesticides produits phytosanitaires composants volatils organiques qualitĆ© de l'eau qualitĆ© de l'air pollution luzerne restructuration du sol entretien du sol protĆ©ines vĆ©gĆ©tales RĆ©sumĆ© : Les lĆ©gumineuses sont les seules cultures agricoles Ć ĆŖtre capables d'utiliser l'azote prĆ©sent dans l'air pour produire leurs propres protĆ©ines, sans nĆ©cessiter d'apport d'engrais azotĆ©s supplĆ©mentaires. Certaines sont Ć©galement trĆØs peu gourmandes en pesticides. Elles ont des effets positifs sur la conservation des sols, la qualitĆ© des eaux souterraines et de surface, la biodiversitĆ©, l'agriculture.
L'utilisation de moins de produits phytosanitaires permet de limiter les composants volatils organiques Ʃmis. Au niveau de la qualitƩ de l'eau, moins de traitements sont nƩcessaires pour obtenir une eau potable. La luzerne est ainsi utilisƩe dans les bassins de captage des eaux de Vittel.
GrĆ¢ce Ć sa densitĆ© et sa profondeur racinaire ainsi qu'Ć sa pĆ©rennitĆ© de 2/3 ans sur la mĆŖme parcelle, la luzerne permet de restructurer le sol. En effet, les racines crĆ©ent une porositĆ© dans la terre qui favorise la vie microbiologique et la microfaune, qui eux mĆŖme permettent l'entretien du sol ainsi que la crĆ©ation de la fertilitĆ© naturelle de celui-ci. Ainsi, les engins agressifs pour l'environnement et coĆ»teux en carburant ne sont pas nĆ©cessaires. La luzerne permet aussi de protĆ©ger du ruissellement et de l'Ć©rosion hydrique. Enfin, la plante permet de lutter contre les mauvaises herbes. De trĆØs nombreuses espĆØces animales trouvent refuge dans la couverture permanente formĆ©e par les lĆ©gumineuses, qui soutiennent ainsi la biodiversitĆ©. Pour finir, les plantes comme la luzerne permettent une Ć©conomie des ressources naturelles sol. La luzerne ne nĆ©cessite que 0,41 hectares pour produire 1 tonne de protĆ©ines, contre 1,3 pour le soja. Les protĆ©ines vĆ©gĆ©tales sont notamment utilisĆ©es pour nourrir les Ć©levages.Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Les lĆ©gumineuses, alliĆ©es dā€™une agriculture Ć©cologiquement intensive. Lā€™exemple de la luzerne [texte imprimĆ©] / Le Chatelier D., Auteur . - 2016.
Tags : lĆ©gumineuse azote engrais pesticides produits phytosanitaires composants volatils organiques qualitĆ© de l'eau qualitĆ© de l'air pollution luzerne restructuration du sol entretien du sol protĆ©ines vĆ©gĆ©tales RĆ©sumĆ© : Les lĆ©gumineuses sont les seules cultures agricoles Ć ĆŖtre capables d'utiliser l'azote prĆ©sent dans l'air pour produire leurs propres protĆ©ines, sans nĆ©cessiter d'apport d'engrais azotĆ©s supplĆ©mentaires. Certaines sont Ć©galement trĆØs peu gourmandes en pesticides. Elles ont des effets positifs sur la conservation des sols, la qualitĆ© des eaux souterraines et de surface, la biodiversitĆ©, l'agriculture.
L'utilisation de moins de produits phytosanitaires permet de limiter les composants volatils organiques Ʃmis. Au niveau de la qualitƩ de l'eau, moins de traitements sont nƩcessaires pour obtenir une eau potable. La luzerne est ainsi utilisƩe dans les bassins de captage des eaux de Vittel.
GrĆ¢ce Ć sa densitĆ© et sa profondeur racinaire ainsi qu'Ć sa pĆ©rennitĆ© de 2/3 ans sur la mĆŖme parcelle, la luzerne permet de restructurer le sol. En effet, les racines crĆ©ent une porositĆ© dans la terre qui favorise la vie microbiologique et la microfaune, qui eux mĆŖme permettent l'entretien du sol ainsi que la crĆ©ation de la fertilitĆ© naturelle de celui-ci. Ainsi, les engins agressifs pour l'environnement et coĆ»teux en carburant ne sont pas nĆ©cessaires. La luzerne permet aussi de protĆ©ger du ruissellement et de l'Ć©rosion hydrique. Enfin, la plante permet de lutter contre les mauvaises herbes. De trĆØs nombreuses espĆØces animales trouvent refuge dans la couverture permanente formĆ©e par les lĆ©gumineuses, qui soutiennent ainsi la biodiversitĆ©. Pour finir, les plantes comme la luzerne permettent une Ć©conomie des ressources naturelles sol. La luzerne ne nĆ©cessite que 0,41 hectares pour produire 1 tonne de protĆ©ines, contre 1,3 pour le soja. Les protĆ©ines vĆ©gĆ©tales sont notamment utilisĆ©es pour nourrir les Ć©levages.Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L230_Le_ChatelierAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Mesurer les Ć©missions de gaz liĆ©es aux activitĆ©s agricoles : des mĆ©thodes et des enjeux Ć raccorder / Hassouna M.

Titre de sĆ©rie : Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230 Titre : Mesurer les Ć©missions de gaz liĆ©es aux activitĆ©s agricoles : des mĆ©thodes et des enjeux Ć raccorder Titre original : Measuring gas emissions from agricultural activities: methods and challenges to connect Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Hassouna M., Auteur ; Eglin T., Auteur ; Robin P., Auteur AnnĆ©e de publication : 2016 Tags : ammoniac Ć©mission diffuse fiabilitĆ© gaz Ć effet de serre incertitude mĆ©thode de mesure standardisation RĆ©sumĆ© : La quantification des Ć©missions de gaz des activitĆ©s agricoles est devenue incontournable si lā€™on souhaite rĆ©pondre aux diffĆ©rents enjeux auxquels lā€™agriculture doit faire face. La particularitĆ© de ce secteur est liĆ©e Ć la multiplicitĆ© des sources dā€™Ć©missions dites Ā« diffuses Ā». Au cours de ces 20 derniĆØres annĆ©es, la communautĆ© scientifique a contribuĆ© au dĆ©veloppement de mĆ©thodes de mesure adaptĆ©es aux gaz ciblĆ©s, aux sources, aux moyens disponibles et aux enjeux. Des protocoles dĆ©taillĆ©s commencent Ć ĆŖtre disponibles et leur standardisation est en cours. NĆ©anmoins, cette Ć©tape ne pourra ĆŖtre complĆØte que lorsque des mĆ©thodes dā€™Ć©valuation des incertitudes sur les mesures seront Ć©galement disponibles. Pollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Mesurer les Ć©missions de gaz liĆ©es aux activitĆ©s agricoles : des mĆ©thodes et des enjeux Ć raccorder = Measuring gas emissions from agricultural activities: methods and challenges to connect [texte imprimĆ©] / Hassouna M., Auteur ; Eglin T., Auteur ; Robin P., Auteur . - 2016.
Tags : ammoniac Ć©mission diffuse fiabilitĆ© gaz Ć effet de serre incertitude mĆ©thode de mesure standardisation RĆ©sumĆ© : La quantification des Ć©missions de gaz des activitĆ©s agricoles est devenue incontournable si lā€™on souhaite rĆ©pondre aux diffĆ©rents enjeux auxquels lā€™agriculture doit faire face. La particularitĆ© de ce secteur est liĆ©e Ć la multiplicitĆ© des sources dā€™Ć©missions dites Ā« diffuses Ā». Au cours de ces 20 derniĆØres annĆ©es, la communautĆ© scientifique a contribuĆ© au dĆ©veloppement de mĆ©thodes de mesure adaptĆ©es aux gaz ciblĆ©s, aux sources, aux moyens disponibles et aux enjeux. Des protocoles dĆ©taillĆ©s commencent Ć ĆŖtre disponibles et leur standardisation est en cours. NĆ©anmoins, cette Ć©tape ne pourra ĆŖtre complĆØte que lorsque des mĆ©thodes dā€™Ć©valuation des incertitudes sur les mesures seront Ć©galement disponibles. Exemplaires(0)
DisponibilitƩ aucun exemplaire Documents numƩriques

L230_HassounaAdobe Acrobat PDFPollution AtmosphƩrique, 229-230. MƩthodologie et Ʃvolution des Ʃmissions de polluants atmosphƩriques dans les inventaires / Mathias E.

PermalinkPermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Prise en compte de la qualitĆ© de lā€™air par le secteur agricole : de la connaissance Ć lā€™action / S. Agasse

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 229-230. Le rĆ´le de lā€™agriculture sur les concentrations en particules dans lā€™atmosphĆØre et lā€™apport de la modĆ©lisation / B. Bessagnet

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 231-232. BĆ¢timent photocatalytique pour le traitement des odeurs / Dussaud J.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 231-232. La campagne Passy-2015 : dynamique atmosphĆ©rique et qualitĆ© de lā€™air dans la vallĆ©e de lā€™Arve / Paci A.

PermalinkPermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 231-232. Les conseillers mĆ©dicaux en environnement intĆ©rieur : lā€™expertise Ć domicile / Lapierre E.

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 231-232. Dans la vallĆ©e de lā€™Arve, une approche innovante de la gestion de la pollution atmosphĆ©rique / I. Roussel

PermalinkPollution AtmosphĆ©rique, 231-232. DECOMBIO - Contribution de la combustion de la biomasse aux PM10 en vallĆ©e de lā€™Arve : mise en place et qualification dā€™un dispositif de suivi / Chevrier F.

Permalink